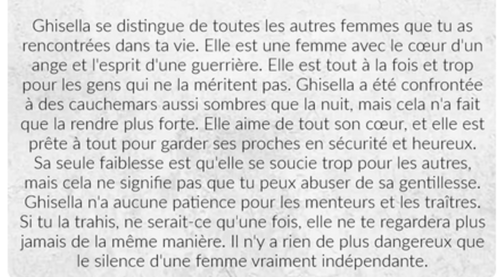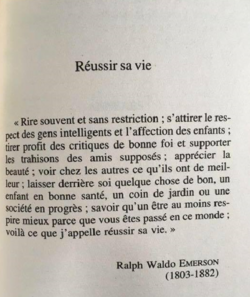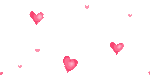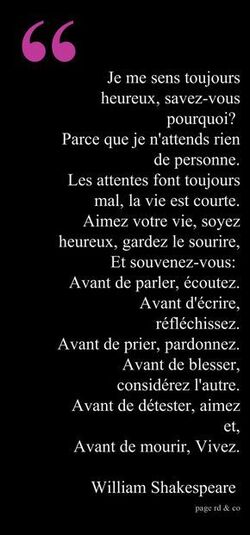-
Devenir de " Michelle Obama" Suite
J’ai passé une grande partie de mon enfance à écouter le son de l’effort. Il parvenait à mes oreilles à travers le plancher de ma chambre sous forme de mauvaise musique, ou plus exactement de musique d’amateur – le plonk plonk plonk des élèves assis un étage plus bas devant le piano de ma grand-tante Robbie, apprenant leurs gammes lentement et laborieusement. Ma famille vivait à Chicago dans le quartier du South Side, dans un coquet pavillon de brique appartenant à Robbie et à son mari, Terry. Mes parents louaient un appartement au premier étage, tandis que Robbie et Terry occupaient le rez-de-chaussée. Robbie était la tante de ma mère et avait été très généreuse avec elle pendant de longues années, mais elle me terrorisait un peu. Guindée et sérieuse, elle dirigeait la chorale d’une église locale tout en étant le professeur de piano attitré du voisinage. Elle portait des chaussures à petits talons et des lunettes au bout d’une chaîne passée autour du cou. Elle avait un sourire espiègle, mais n’aimait pas l’esprit sarcastique qu’affectionnait ma mère. Il m’arrivait de l’entendre houspiller les élèves qui n’avaient pas assez travaillé ou les parents qui les avaient déposés en retard à leur leçon.
« Bonne nuit ! » s’écriait-elle en plein jour, avec l’exaspération volcanique qu’un autre aurait pu mettre dans « Bon sang de bonsoir ! » Peu de gens, semblait-il, étaient à la hauteur des attentes de Robbie.
L’écho produit par des élèves qui s’efforçaient d’apprendre constituait le fond sonore de notre vie. Ça pianotait l’après-midi, ça pianotait dans la soirée. Des dames de l’église venaient quelquefois répéter des cantiques, bramant leur piété à travers nos murs. En vertu des règles de Robbie, les enfants qui prenaient des cours de piano n’étaient autorisés à travailler qu’un morceau à la fois. Depuis ma chambre, je les entendais s’évertuer, note par note, non sans errements,
à obtenir son approbation, passant, au fil de leurs progrès et au terme de nombreuses tentatives, de comptines comme Hot Cross Buns à la Berceuse de Brahms. La musique n’était jamais agaçante ; simplement persistante. Elle se glissait dans la cage d’escalier qui séparait notre logement de celui de Robbie. Elle s’insinuait par les fenêtres ouvertes l’été, accompagnant mes pensées pendant que je jouais à la Barbie ou empilais mes cubes pour construire de petits royaumes. Nous ne connaissions de répit que quand mon père rentrait tôt de la station municipale d’épuration des eaux où il travaillait et allumait la télé pour regarder un match de base-ball des Cubs, montant le son assez fort pour couvrir les autres bruits.
C’était la fin des années 1960 dans le South Side de Chicago. Les Cubs n’étaient pas mauvais, mais ils n’avaient rien d’exceptionnel non plus. Blottie sur les genoux de mon papa assis dans son fauteuil relax, je l’écoutais dire que les Cubs connaissaient une baisse de régime en cette fin de saison ou expliquer pourquoi Billy Williams, qui vivait juste au bout de la rue sur Constance Avenue, était capable de réaliser des frappes incroyables depuis la gauche du marbre. Hors des stades de base-ball, l’Amérique était en plein changement – un changement aussi massif qu’incertain. Les Kennedy étaient morts. Martin Luther King avait été tué sur un balcon de Memphis, un assassinat qui avait provoqué des émeutes dans tout le pays, y compris à Chicago. À la convention nationale démocrate de 1968, le sang avait coulé quand la police s’en était prise à coups de matraque et de gaz lacrymogène aux manifestants qui protestaient contre la guerre du Vietnam à Grant Park, à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Dans le même temps, des familles blanches quittaient la ville en masse, attirées par les banlieues – par la promesse de meilleures écoles, de plus d’espace, de plus de blancheur aussi, sans doute.
Tout ça me passait largement au-dessus de la tête. Je n’étais qu’une gamine qui jouait à la Barbie et aux cubes. J’avais un père, une mère, et un frère aîné dont la tête, toutes les nuits, reposait à moins d’un mètre de la mienne. Ma famille représentait tout mon univers, c’était le centre de tout. Ma mère m’a appris à lire tôt : elle m’accompagnait à la bibliothèque publique et s’asseyait à côté de moi pendant que je déchiffrais tout haut des mots sur une page. Mon père partait travailler tous les matins dans son uniforme bleu d’employé municipal, mais, le soir, il nous transmettait son amour du jazz et de l’art. Il avait suivi des cours à l’Art Institute de Chicago quand il était petit, et pris des cours de peinture et de sculpture au lycée. À l’école, il avait participé à des compétitions de natation et de boxe, et, devenu adulte, il adorait tous les sports qui passaient à la télé, du golf professionnel au hockey. Il aimait voir des gens très forts se surpasser. Quand mon frère s’est pris de passion pour le basket, mon père s’est mis à poser des pièces de monnaie au-dessus du montant de la porte de la cuisine, et l’encourageait à sauter pour les attraper.
Tout ce qui comptait pour moi se trouvait dans un rayon de cinq rues – mes grands-parents et mes cousins, l’église du coin où nous n’allions pas très régulièrement au catéchisme, la station-service où ma mère m’envoyait parfois chercher un paquet de cigarettes, et le magasin d’alcool, qui vendait aussi du pain de mie, des bonbons et du lait. Par les chaudes soirées d’été, nous nous endormions, mon frère et moi, au son des acclamations qui scandaient les matchs senior de softball dans le parc public voisin, où, dans la journée, nous grimpions sur les agrès de l’aire de jeux et jouions à chat avec les autres gamins.
Nous n’avons pas tout à fait deux ans d’écart, Craig et moi. Il a les yeux doux et l’optimisme de mon père, l’inflexibilité de ma mère. Nous avons toujours été très proches, en partie grâce à l’allégeance inébranlable et quelque peu inexplicable qu’il a vouée d’emblée à sa petite sœur. Il existe une vieille photo en noir et blanc de nous quatre assis sur un canapé, ma mère souriante et mon père, fier et sérieux, nous tenant Craig et moi sur leurs genoux. Nous sommes habillés pour aller à l’église, ou peut-être à un mariage. Je dois avoir huit mois, une armoire à glace en couche-culotte et au visage grassouillet, la mine résolue, apparemment prête à échapper à ma mère, les yeux rivés sur l’appareil photo comme si j’allais me jeter dessus. Craig est à côté de moi, un vrai petit monsieur en veston et nœud papillon, l’air grave. Du haut de ses 2 ans seulement, il est déjà l’incarnation du grand frère vigilant et responsable – le bras tendu vers le mien, ses doigts entourant mon poignet dodu dans un geste protecteur.
Quand cette photo a été prise, nous vivions en face de chez les parents de mon père, de l’autre côté du couloir, à Parkway Gardens, un grand ensemble moderniste du South Side regroupant des immeubles bon marché. Cette cité, construite dans les années 1950, avait été conçue sous forme de coopérative, en vue de remédier à la pénurie de logements chez les familles noires modestes après la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, la pauvreté et la violence des gangs entraîneraient la dégradation de ces immeubles qui deviendraient un des lieux d’habitation les plus dangereux de la ville. Mais bien avant cela, quand j’étais encore toute petite, mes parents – qui s’étaient rencontrés à l’adolescence et s’étaient mariés vers 25 ans – acceptèrent une offre qui les conduisit à s’installer quelques kilomètres plus au sud, chez Robbie et Terry, dans un quartier plus agréable.
Sur Euclid Avenue, nous vivions à deux ménages sous un seul toit, pas très grand. À en juger par son agencement, le premier étage avait probablement été destiné à loger une ou deux personnes appartenant à la même famille que les occupants du rez-de-chaussée, mais nous nous débrouillions pour y tenir à quatre. Mes parents dormaient dans l’unique chambre à coucher tandis que Craig et moi partagions une pièce plus spacieuse qui aurait dû, je pense, servir de salon.Plus tard, quand nous avons été un peu plus grands, mon grand-père – Purnell Shields, le père de ma mère, un menuisier enthousiaste, à défaut d’être très compétent – a apporté des panneaux de bois bon marché pour fabriquer une cloison de fortune divisant l’espace en deux pièces plus ou moins isolées. Il a ajouté une porte en accordéon dans chaque partie et aménagé sur l’avant un petit espace de jeu commun, où nous pouvions ranger nos jouets et nos livres.
J’adorais ma chambre. Elle était juste assez grande pour contenir un petit lit et un bureau étroit. Je disposais toutes mes peluches sur mon lit, les rassemblant laborieusement chaque soir tout autour de ma tête pour me rassurer. De son côté de la paroi, Craig vivait une sorte d’existence en miroir avec son propre lit poussé contre la cloison, parallèlement au mien. La partition était si mince que nous pouvions bavarder au lit le soir, nous amusant souvent à nous jeter une chaussette roulée en boule de part et d’autre de l’espace de vingt centimètres qui séparait le haut de la cloison du plafond.
Tante Robbie, quant à elle, avait transformé sa partie de la maison en une sorte de mausolée, emmaillotant ses meubles de housses en plastique, froides et collantes sous mes jambes nues quand j’avais l’audace de m’y asseoir. Ses étagères étaient bourrées de figurines de porcelaine auxquelles nous n’avions pas le droit de toucher. Il m’arrivait de laisser planer ma main au-dessus d’une famille de caniches en verre qui avaient l’air gentils – une mère délicate et trois minuscules chiots – avant de la retirer précipitamment, redoutant la colère de Robbie. Quand elle ne donnait pas de leçons, un silence de mort régnait au rez-de-chaussée. La télévision n’était jamais allumée, la radio non plus. Je ne suis même pas sûre qu’ils se soient beaucoup parlé, en bas. Le nom complet du mari de Robbie était William Victor Terry, mais, je ne sais pourquoi, nous ne l’appelions que par son nom de famille. Terry était comme une ombre, un monsieur distingué qui portait des costumes trois pièces tous les jours de la semaine et ne disait pas un mot, ou presque.
J’avais fini par considérer l’étage et le rez-de-chaussée comme deux univers différents, régis par des sensibilités rivales. Au premier, nous étions bruyants, et sans vergogne. Nous jouions à la balle, Craig et moi, et nous nous courions après dans tout l’appartement. Nous aspergions le sol du couloir de cire à plancher pour pouvoir glisser plus vite sur nos chaussettes, nous cognant souvent aux murs. Nous organisions des matchs de boxe frère contre sœur à la cuisine, utilisant les paires de gants que papa nous avait offertes pour Noël, accompagnées d’instructions personnalisées sur la meilleure méthode pour balancer un coup droit. Le soir, nous jouions à des jeux de société en famille, nous racontions des histoires et des blagues, et écoutions des disques des Jackson 5 sur la chaîne stéréo. Quand Robbie n’en pouvait plus, elle actionnait avec insistance l’interrupteur de notre cage d’escalier commune qui commandait aussi l’ampoule du couloir de notre étage, allumant et éteignant, encore et encore – une façon plus ou moins polie de nous prier de bien vouloir baisser d’un ton.
Robbie et Terry étaient plus vieux. Ils avaient grandi à une époque différente et avaient d’autres soucis que nous. Ils avaient vu des choses que nos parents n’avaient pas vues – des choses que Craig et moi, dans notre puérilité tapageuse, n’aurions même pas pu imaginer. C’était ce que ma mère nous disait quand les ronchonnements du rez-de-chaussée nous mettaient à cran. Même si nous ignorions ce passé, on nous demandait de nous rappeler que ce passé existait. Tout le monde sur terre, nous répétaient nos parents, était porteur d’une histoire invisible, et méritait d’être considéré avec un minimum de tolérance. Bien des années plus tard, j’ai appris que Robbie avait engagé des poursuites contre l’université Northwestern pour discrimination, car elle s’y était inscrite en 1943 à un atelier de musique chorale et n’avait pas pu obtenir de chambre dans la résidence universitaire féminine. On lui avait conseillé d’aller s’installer dans un immeuble de la ville où on louait des chambres – un endroit pour les « gens de couleur », lui avait-on précisé. Quant à Terry, il avait été autrefois porteur de la Pullman sur une des lignes de trains de nuit au départ et à l’arrivée de Chicago. C’était un métier respectable mais mal payé, exercé exclusivement par des Noirs qui veillaient à ce que leurs uniformes soient toujours immaculés, alors même qu’ils trimbalaient des bagages, servaient des repas et, plus généralement, satisfaisaient tous les besoins des passagers, allant jusqu’à cirer leurs chaussures.Terry parle, qu’il révèle tous ses secrets. J’imaginais qu’il avait une multitude d’histoires passionnantes à raconter sur les villes qu’il avait traversées, sur ce que faisaient, ou ne faisaient pas, les riches qui prenaient le train. Mais nous ne saurions jamais rien de tout cela. Pour je ne sais quelle raison, il n’en a jamais parlé.
Je devais avoir 4 ans quand j’ai décrété que je voulais faire du piano. Craig, qui était alors au cours préparatoire, effectuait déjà des virées au rez-de-chaussée pour des leçons hebdomadaires sur le piano droit de Robbie et en revenait à peu près indemne. Je pensais être prête. En réalité, j’étais plus ou moins convaincue d’avoir déjà appris à jouer du piano, par un phénomène d’osmose verticale – toutes ces heures passées à écouter d’autres enfants batailler avec leurs morceaux. J’avais déjà la musique en tête. Tout ce que je voulais, c’était descendre chez ma grand-tante pointilleuse et lui montrer quelle petite fille douée j’étais, lui faire comprendre que je n’aurais aucun mal à devenir la plus brillante de ses élèves.
Le piano de Robbie se trouvait dans une petite pièce carrée sur l’arrière de la maison, à côté d’une fenêtre donnant sur le jardin. Il y avait une plante verte dans un coin et, dans un autre, une table pliante où les élèves pouvaient travailler à leurs exercices de solfège. Pendant les cours, elle s’asseyait, droite comme un i, dans un fauteuil rembourré à haut dossier, tapant la mesure d’un doigt, la tête inclinée, à l’affût de la moindre erreur. Avais-je peur de Robbie ? Pas vraiment, mais elle avait indéniablement quelque chose d’effrayant ; elle incarnait une forme d’autorité rigide qui m’était inconnue. Elle exigeait l’excellence de tous les enfants qui posaient leurs fesses sur son tabouret de piano. Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver.Plusieurs années après son départ à la retraite, Terry vivait toujours Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver. dans un état de formalité léthargique – impeccablement habillé, vaguement servile, ne s’affirmant jamais d’aucune manière, à mes yeux en tout cas. C’était comme si, pour s’en sortir, il avait renoncé à une partie de lui-même. Je le voyais tondre notre pelouse dans la chaleur accablante de l’été avec ses belles chaussures bout golf, ses bretelles et son borsalino à bord étroit, les manches de sa chemise élégante soigneusement retroussées. Il se permettait une cigarette par jour, pas davantage, et un cocktail par mois – et, même en cette occasion, il n’était jamais détendu comme pouvaient l’être mon père et ma mère après avoir pris un apéritif ou une bière, ce qui leur arrivait plusieurs fois par mois. Au fond de moi, j’avais envie que Terry parle, qu’il révèle tous ses secrets. J’imaginais qu’il avait une multitude d’histoires passionnantes à raconter sur les villes qu’il avait traversées, sur ce que faisaient, ou ne faisaient pas, les riches qui prenaient le train. Mais nous ne saurions jamais rien de tout cela. Pour je ne sais quelle raison, il n’en a jamais parlé.
Je devais avoir 4 ans quand j’ai décrété que je voulais faire du piano. Craig, qui était alors au cours préparatoire, effectuait déjà des virées au rez-de-chaussée pour des leçons hebdomadaires sur le piano droit de Robbie et en revenait à peu près indemne. Je pensais être prête. En réalité, j’étais plus ou moins convaincue d’avoir déjà appris à jouer du piano, par un phénomène d’osmose verticale – toutes ces heures passées à écouter d’autres enfants batailler avec leurs morceaux. J’avais déjà la musique en tête. Tout ce que je voulais, c’était descendre chez ma grand-tante pointilleuse et lui montrer quelle petite fille douée j’étais, lui faire comprendre que je n’aurais aucun mal à devenir la plus brillante de ses élèves .Le piano de Robbie se trouvait dans une petite pièce carrée sur l’arrière de la maison, à côté d’une fenêtre donnant sur le jardin. Il y avait une plante verte dans un coin et, dans un autre, une table pliante où les élèves pouvaient travailler à leurs exercices de solfège. Pendant les cours, elle s’asseyait, droite comme un i, dans un fauteuil rembourré à haut dossier, tapant la mesure d’un doigt, la tête inclinée, à l’affût de la moindre erreur. Avais-je peur de Robbie ? Pas vraiment, mais elle avait
indéniablement quelque chose d’effrayant ; elle incarnait une forme d’autorité rigide qui m’était inconnue. Elle exigeait l’excellence de tous les enfants qui posaient leurs fesses sur son tabouret de piano. Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver.
Perchée sur le tabouret pour mon premier cours, j’avais les jambes ballantes, trop courtes pour toucher le sol. Robbie m’a donné mon propre cahier d’exercices pour débutants, ce qui m’a ravie, et m’a montré comment placer correctement mes mains sur le clavier. « Bon, concentre-toi, m’a-t-elle dit, me grondant avant même que nous ayons commencé. Trouve-moi le do du milieu. »
Quand on est petit, on peut avoir l’impression qu’un piano possède mille touches. On a sous les yeux une étendue de noir et de blanc plus longue que deux petits bras écartés. Le do du milieu, n’ai-je pas tardé à apprendre, était le point d’ancrage. C’était la frontière entre le territoire de la main droite et celui de la main gauche, entre les clés de sol et de fa. Il suffisait de poser le pouce sur le do du milieu pour que tout le reste se mette en place automatiquement. Les touches du piano de Robbie présentaient une subtile irrégularité de couleur et de forme ; à certains endroits, des fragments d’ivoire s’étaient détachés avec le temps, donnant au clavier l’aspect d’une rangée de dents gâtées. Par bonheur, il manquait tout un angle au do du milieu, un coin à peu près de la taille d’un de mes ongles, ce qui m’aidait à placer correctement mes mains à tous les coups.
J’ai découvert que j’aimais le piano. Il me paraissait tout naturel d’en jouer, comme si j’y étais destinée. Les musiciens et les mélomanes étaient nombreux dans ma famille, surtout du côté de ma mère. Un de mes oncles jouait dans une fanfare professionnelle. Plusieurs de mes tantes chantaient dans des chorales paroissiales. Robbie, elle, en plus de sa chorale et de ses leçons de piano, avait monté l’Operetta Workshop, un atelier de théâtre musical à tout petit budget pour les enfants, auquel nous assistions, Craig et moi, tous les samedis matin dans le sous-sol de son église. Mais le vrai pilier musical de la famille était mon grand-père Shields, le menuisier, et petit frère de Robbie. C’était un homme insouciant, ventripotent, au rire communicatif, qui portait une barbe poivre et sel en bataille. Quand j’étais plus petite, il habitait l’ouest de la ville, le West Side. Mon frère et moi l’avions donc surnommé Westside. Lorsqu’il est venu s’installer dans notre quartier l’année où j’ai commencé à prendre des cours de piano, nous l’avons dûment rebaptisé Southside.
Southside s’était séparé de ma grand-mère plusieurs dizaines d’années auparavant, quand ma mère était adolescente. Il vivait avec ma tante Carolyn, la sœur aînée de ma mère, et mon oncle Steve, son plus jeune frère, à deux rues de nous seulement, dans une confortable maison de plain-pied qu’il avait équipée pour la musique du sol au plafond, installant des haut-parleurs dans toutes les pièces, jusque dans la salle de bains. Il avait fabriqué dans la salle à manger un système compliqué de placards pour ranger son matériel stéréo, en grande partie récupéré dans des vide-greniers. Il avait deux platines dépareillées auxquelles s’ajoutaient un vieux magnétophone à bandes branlant et des étagères ployant sous les disques qu’il avait accumulés au fil des ans.
Southside se méfiait de beaucoup de choses. C’était une sorte de vieil adepte endurci des théories du complot. Comme il ne faisait pas confiance aux dentistes, il n’avait pour ainsi dire plus de dents. Il ne se fiait pas à la police et pas toujours aux Blancs non plus, car il était le petit-fils d’un esclave géorgien et avait passé sa petite enfance dans l’Alabama du temps de la ségrégation, avant de se rendre dans le nord, à Chicago, dans les années 1920. Quand il avait eu des enfants, Southside n’avait pas ménagé sa peine pour leur éviter tous les ennuis – les terrifiant à grand renfort d’histoires réelles et imaginaires sur ce qui pouvait arriver aux enfants noirs qui avaient le malheur d’aller dans le mauvais quartier, les sermonnant pour qu’ils s’efforcent de ne jamais avoir affaire à la police.
La musique était sans doute un antidote à ses soucis, une manière de les oublier et de se détendre. Quand Southside avait touché sa paie pour une journée de travail de menuisier, il lui arrivait de s’autoriser une folie et de s’acheter un nouveau disque. Il organisait régulièrement des fêtes de famille, obligeant tout le monde à s’égosiller pour couvrir le son qui provenait de la chaîne. Nous célébrions la plupart des grands événements de notre vie chez Southside ; c’est ainsi que, au fil des ans, nous avons déballé nos cadeaux de Noël sur la musique d’Ella Fitzgerald et soufflé nos bougies d’anniversaire sur celle de Coltrane. À en croire ma mère, dans sa jeunesse, Southside s’était fait un devoir d’inoculer le jazz à ses sept enfants, n’hésitant pas à réveiller toute la maisonnée au point du jour en faisant passer un de ses disques à plein volume.
Son amour pour la musique était contagieux. Une fois Southside installé dans notre quartier, j’ai passé des après-midi entiers chez lui, prenant des disques au hasard sur ses étagères et les posant sur la chaîne, chacun me plongeant dans une aventure différente. J’avais beau être petite, j’avais le droit de toucher à tout. C’est Southside qui m’a acheté plus tard mon premier disque, Talking Book de Stevie Wonder, que je gardais chez lui sur une étagère réservée à mes disques préférés. Si j’avais faim, il me préparait un milkshake ou nous faisait frire un poulet entier pendant que nous écoutions Aretha, Miles ou Billie. Je portais Southside aux nues. Et les nues, telles que je les imaginais, ne pouvaient qu’être un endroit plein de jazz.
Chez moi, je continuais à travailler dur pour progresser. Assise devant le piano droit de Robbie, je n’ai pas tardé à connaître parfaitement mes gammes – le phénomène d’osmose était on ne peut plus réel – et je me suis plongée dans les exercices de déchiffrage qu’elle me donnait. Comme nous n’avions pas de piano chez nous, je devais travailler en bas, sur le sien. J’attendais donc le moment où elle n’avait pas d’élève et traînais souvent ma mère avec moi, l’obligeant à s’asseoir dans le fauteuil capitonné pour m’écouter jouer. J’apprenais un morceau du manuel, puis un autre. Je n’étais sans doute pas meilleure que les autres élèves de ma grand-tante ni moins maladroite, mais j’étais motivée. Pour moi, le simple fait d’apprendre était magique. J’en tirais une forme de satisfaction exaltante. D’abord, j’avais saisi la corrélation simple et encourageante entre le temps que je consacrais à travailler et les résultats que j’obtenais. Et j’avais aussi senti en Robbie quelque chose de trop profondément enfoui pour qu’on puisse parler de vrai plaisir, mais tout de même, l’ébauche d’une forme de légèreté inhabituelle, de bonheur presque, qui émanait d’elle quand je parvenais à jouer tout un morceau sans le saboter, quand ma main droite faisait jaillir une mélodie pendant que la gauche frappait un accord. Je le remarquais du coin de l’œil : les lèvres de Robbie se desserraient imperceptiblement ; le doigt qui tapait la mesure effectuait un petit sautillement.
Ce fut pour nous une période d’état de grâce. Peut-être aurions-nous pu poursuivre sur cette lancée, Robbie et moi, si j’avais été moins curieuse et plus respectueuse de ses méthodes d’apprentissage du piano. Mais le manuel était si gros et mes progrès sur les premiers morceaux si lents que je me suis impatientée et que, furtivement, je suis allée voir plus loin – ne sautant pas seulement quelques pages, mais me plongeant au cœur du manuel, consultant les morceaux destinés aux élèves plus avancés et me mettant, pendant mes séances de travail personnel, à bricoler pour parvenir à les jouer. Le jour où, toute fière, j’ai entamé un de ces morceaux devant Robbie, elle a explosé, dénigrant mon exploit d’un fielleux « Bonne nuit ! ». Je venais de me faire houspiller comme je l’avais entendue houspiller je ne sais combien d’élèves avant moi. Je n’avais fait qu’essayer d’apprendre plus, et plus vite, mais Robbie y voyait quasiment un acte de trahison. Elle n’était pas impressionnée, mais alors pas du tout.
Pas plus que je n’étais contrite. J’étais le genre d’enfant qui aime obtenir des réponses concrètes et pousser les raisonnements jusqu’à leur aboutissement logique, si épuisant que cela puisse être. J’étais une ergoteuse tendance dictatoriale, comme pouvait l’attester mon frère, qui se voyait souvent expulsé autoritairement de notre espace de jeu commun. Quand j’estimais avoir une bonne idée, je n’aimais pas qu’on m’interdise d’aller jusqu’au bout. Voilà comment ma grand-tante et moi avons fini par nous heurter de front, aussi remontées l’une que l’autre, et aussi inflexibles.
« Je ne comprends pas que tu sois fâchée contre moi simplement parce que j’ai eu envie d’apprendre un nouveau morceau !
– Tu n’es pas prête. Ce n’est pas comme ça qu’on apprend à jouer du piano.
– Mais je suis prête. Je viens de te le jouer.
– Ce n’est pas comme ça qu’on fait.
– Mais pourquoi ? »
Les cours de piano sont devenus une épreuve épique et épuisante, en grande partie à cause de mon refus de suivre la méthode que Robbie voulait m’imposer et du refus de Robbie d’accorder le moindre crédit à mon approche désinvolte de son manuel. Dans mon souvenir, nous avons passé des semaines à nous disputer. J’étais têtue ; elle aussi. J’avais un point de vue ; elle aussi. Entre nos querelles, je continuais à jouer et elle continuait à m’écouter, me noyant sous un torrent de critiques. Je ne la créditais guère de mes progrès, et de son côté elle ne m’en attribuait guère le mérite. Il n’empêche que les leçons ont continué.
À l’étage, mes parents et Craig trouvaient tout ça très amusant. Ils s’écroulaient de rire à table quand je racontais mes joutes avec Robbie, fulminant encore tout en dévorant mes spaghetti et mes boulettes de viande. Craig, lui, s’entendait très bien avec Robbie : c’était un garçon joyeux et consciencieux, qui ne s’investissait que superficiellement dans l’étude du piano. Mes parents n’exprimaient pas la moindre compassion pour mes tourments, pas plus, au demeurant, que pour ceux de Robbie. En règle générale, ils n’intervenaient pas dans des questions autres que scolaires, nous laissant rapidement, mon frère et moi, régler nos affaires tout seuls. Ils semblaient estimer que leur tâche consistait essentiellement à nous écouter et à nous soutenir, au besoin, entre les quatre murs de notre maison. Je sais que d’autres parents auraient pu reprocher à leur enfant d’être aussi impertinent avec un adulte, mais les miens m’ont laissée faire. Ma mère avait vécu par intermittence avec Robbie depuis ses 16 ans, obéissant à toutes les règles ésotériques que celle-ci lui imposait, et peut-être était-elle secrètement satisfaite de voir quelqu’un défier son autorité. Avec le recul, je crois que mes parents appréciaient ma pugnacité et je leur en sais gré. C’était une flamme qui brûlait en moi et qu’ils s’employaient à entretenir.
Une fois par an, Robbie organisait un récital en bonne et due forme pour donner à ses élèves l’occasion de jouer devant un vrai public. J’ignore encore comment, mais elle avait réussi à obtenir qu’on mette à sa disposition une salle de répétition à l’université Roosevelt, au centre de Chicago, ce qui lui permettait de donner ses petits concerts dans un grandiose bâtiment de pierre de Michigan Avenue, juste à côté de la salle où se produisait le Chicago Symphony Orchestra. La seule idée d’y aller m’angoissait. Notre appartement d’Euclid Avenue se trouvait à une quinzaine de kilomètres au sud du quartier d’affaires du Chicago Loop qui, avec ses gratte-ciel étincelants et ses trottoirs bourrés de monde, m’apparaissait comme un autre univers. Ma famille ne se rendait au cœur de la ville qu’une poignée de fois par an, pour faire un tour à l’Art Institute ou assister à une pièce de théâtre, voyageant tous les quatre comme des astronautes dans la capsule spatiale de la Buick paternelle.
Mon père ne manquait pas une occasion de prendre le volant. Il adorait sa voiture, une Buick Electra 225 couleur bronze, qu’il appelait avec orgueil la « Deux vingt-cinq ». Elle était toujours lustrée et cirée, et il était très à cheval sur le calendrier d’entretien, la menant chez Sears pour faire changer les pneus et l’huile avec autant de régularité que maman nous conduisait chez le pédiatre pour des bilans de santé. Noucher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon s adorions la Deux vingt-cinq, nous aussi. Avec ses lignes douces et ses feux arrière étroits, elle avait une allure cool et futuriste. Elle était tellement spacieuse qu’on avait l’impression d’être dans une maison. Je pouvais presque m’y tenir debout, caressant de mes mains le plafond recouvert de tissu. À l’époque, le port de la ceinture de sécurité n’était pas obligatoire, si bien que, la plupart du temps, Craig et moi chahutions à l’arrière, nous penchant au-dessus du siège avant pour parler à nos parents. Je faisais la moitié des trajets le menton calé sur le siège du conducteur, pour placer mon visage juste à côté de celui de mon père et voir exactement la même chose que lui.
La voiture offrait à la famille une autre forme d’intimité, une occasion de parler tout en nous déplaçant. Le soir après le dîner, Craig et moi demandions parfois à mon père de nous emmener faire un tour, sans but particulier. Certaines soirées d’été, nos parents nous faisaient la surprise de nous conduire dans un cinéma en plein air, au sud-ouest de notre quartier, pour voir La Planète des singes. Nous garions la Buick au crépuscule et nous installions pour la séance. Ma mère nous servait du poulet frit et des chips qu’elle avait apportés et mon frère et moi mangions sur nos genoux, sur la banquette arrière, en faisant attention de bien nous essuyer les mains sur nos serviettes et pas sur les sièges.
Je ne comprendrais que bien des années plus tard ce que cette voiture représentait pour mon père. Enfant, je ne pouvais qu’en avoir l’intuition – la libération qu’il éprouvait au volant, le plaisir que lui procuraient la marche régulière du moteur et le bourdonnement de pneus parfaitement équilibrés sous lui. Il n’avait pas encore 40 ans quand un médecin lui avait annoncé que l’étrange faiblesse qu’il avait commencé à ressentir dans une jambe n’était que le début d’un long et probablement douloureux déclin qui s’achèverait par la pcher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon aralysie ; qu’il y avait de fortes chances pour qu’un jour, à la suite de mystérieuses lésions de la gaine des neurones de son cerveau et de sa moelle épinière, il ne puisse plus marcher du tout. Je n’ai pas retenu les dates précises, mais je crois que la Buick a fait son apparition dans la vie de mon père à peu près au même moment que la sclérose en plaques. Et, bien qu’il ne l’ait jamais dit, la voiture lui apportait certainement une forme indirecte de libération.
Ni lui ni ma mère ne se sont appesantis sur ce diagnostic. Nous étions encore à des décennies du temps où une simple recherche sur Google aurait livré une masse étourdissante de graphiques, de statistiques et d’explications médicales propres à faire naître ou disparaître l’espoir. En tout état de cause, je pense que mon père n’aurait pas voulu les voir. Malgré l’éducation religieuse qu’il avait reçue, il n’aurait certainement pas prié Dieu de lui épargner cette épreuve. Il ne se serait pas mis en quête de thérapies alternatives, ne se serait pas tourné vers un gourou, n’aurait pas blâmé quelque gène défectueux. Dans ma famille, nous avons la solide habitude de refouler les mauvaises nouvelles ou d’essayer de les oublier, presque dès l’instant où elles arrivent. Personne ne savait depuis combien de temps mon père s’était senti mal avant d’aller consulter un médecin pour la première fois ; mais, à mon avis, il a dû attendre des mois, sinon des années. Il n’aimait pas les rendez-vous médicaux. C’était le genre d’homme à accepter ce qui lui arrivait et à continuer à aller de l’avant.
Ce que je sais, c’est que, le jour de mon grand récital de piano, il marchait déjà avec une légère claudication : son pied gauche était incapable de suivre parfaitement le droit. Tous les souvenirs que je garde de mon père comprennent une manifestation quelconque de son infirmité, même si aucun de nous n’était encore tout à fait prêt à employer ce mot. Je savais à l’époque qu’il marchait un peu plus lentement que les autres papas. Je le voyais parfois s’arrêter avant de gravir une volée de marches, comme s’il devait réfléchir à la manœuvre avant de la tenter. Quand nous allions faire des courses au centre commercial, il s’installait à l’écart sur un banc, surveillait les sacs ou faisait une petite sieste pendant que le reste de la famille se baladait tranquillement.
Je me revois le jour où nous nous sommes rendus en ville pour le récital de piano, assise sur la banquette arrière de la Buick dans une jolie robe, chaussée de souliers vernis, mes cheveux tressés. J’étais en proie au trac pour la première fois de ma vie. Jouer m’angoissait, même si en bas, ccher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon hez Robbie, j’avais travaillé mon morceau jusqu’à l’épuisement. Craig était lui aussi sur son trente et un, et s’apprêtait lui aussi à jouer. Une perspective qui ne lui faisait ni chaud ni froid. En fait, il dormait à poings fermés sur la banquette arrière, la bouche ouverte, l’air bienheureux et parfaitement paisible. Du Craig tout craché. Sa sérénité ne cesserait jamais de m’étonner. À l’époque, il jouait dans une équipe junior de basket qui disputait des matchs toutes les semaines et, de toute évidence, il avait déjà appris à maîtriser ses nerfs.
Mon père choisissait généralement un parking aussi proche que possible de notre destination : il préférait payer un peu plus cher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine lcher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon égèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien monmorceau que j’avais à peine besoin d’y penser. Il suffisait que mes mains se mettent en mouvement.
Il y avait pourtant un problème que j’ai découvert dans la fraction de seconde qu’il m’a fallu pour poser mes petits doigts sur les touches. J’étais devant un piano irréprochable, aux surfaces soigneusement époussetées, aux cordes accordées avec précision, ses quatre-vingt-huit touches disposées en un ruban blanc et noir sans défaut. L’ennui était que je n’étais pas habituée à une telle perfection. Je n’y avais même jamais été confrontée. Je n’avais jamais joué du piano ailleurs que dans la petite salle de musique exiguë de Robbie, avec sa plante en pot hirsute et sa vue sur notre modeste jardin. Le seul instrument sur lequel j’avais joué était son piano droit approximatif, avec son patchwork boiteux de touches jaunies et son do du milieu commodément ébréché. Pour moi, un piano, c’était ça – comme mon quartier était mon quartier, mon papa mon papa, ma vie ma vie. Je ne connaissais rien d’autre.
Et voilà que, soudain, j’ai eu conscience que des gens me regardaient depuis leurs sièges, alors que j’avais les yeux rivés sur la surface lustrée et parfaitement uniforme des touches du piano. Je ne savais absolument pas où poser les mains. La gorge nouée, le cœur battant, je me suis tournée vers le public, m’efforçant de ne pas laisser voir ma panique, recherchant le havre sûr du visage maternel. Au lieu de quoi, j’ai aperçu une silhouette se lever de la première rangée et l'éviter lentement dans ma direction. C’était Robbie. Nous nous étions déjà beaucoup bagarrées, au point que je la considérais un peu comme une ennemie. Mais au moment précis où je n’allais recevoir, après tout, que ce que je méritais, elle s’est approchée de moi presque comme un ange et s’est arrêtée derrière mon épaule. Peut-être avait-elle compris mon désarroi. Peut-être savait-elle que les inégalités du monde venaient de m’apparaître silencieusement pour la première fois. Ou peut-être n’avait-elle simplement pas de temps à perdre. Quoi qu’il en soit, sans un mot, Robbie a doucement posé un doigt sur le do du milieu pour que je sache où commencer. Puis, se retournant avec un imperceptible sourire d’encouragement, elle m’a laissée jouer mon morceau.FIN
Couverture : Création graphique : Christopher Brand © Librairie Arthème Fayard, 2018, pour la traduction française.
Dépôt légal : novembre 2018
ISBN : 978-2-213-70787-7
Dépôt légal : novembre 2018
Adaptation de la maquette de couverture : Nuit de Chine
Photographie : Miller Mobley
Cet ouvrage est la traduction intégrale,
publiée pour la première fois en France,
du livre de langue anglaise :
Becoming
publié aux États-Unis par Crown,
marque de Crown Publishing Group,
division de Penguin Random House LLC, New York.
© Michelle Obama, 2018
-
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Vous devez être connecté pour commenter