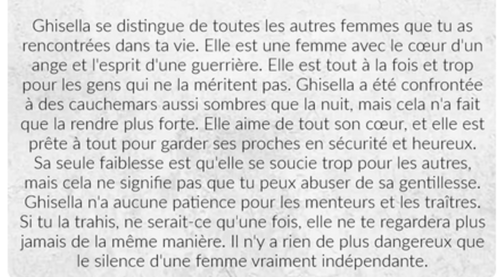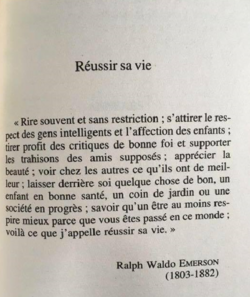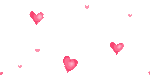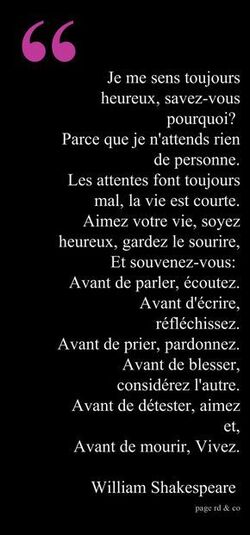-
Par Harmonie32 le 12 Octobre 2020 à 06:07
Je vous souhaite une excellent semaine avec ces merveilleuses images qui font parties du monde dans lequel nous vivons… et si nous cessions de nous axer uniquement sur le négatif ?
Je reste une grande optimiste ainsi je n’ai rien à perdre, car si toutefois le monde ne va pas dans le sens que je souhaite, j’aurai eu une vie heureuse, au lieu de l’avoir passée dans la morosité et la souffrance du négativisme.
A méditer…
Réponse pour celle qui se pose des questions J'ai laissé en suspend ce blog ou il y avait nos voyages nos vacances ,nos promenade les déplacement de notre fils en Inde au Brésil En Malaisie ,Dubaï exétéra.. J'ai effacé car j'en avais marre de venir ici j'ai laissé cette espace en suspend pendant deux années , voilà pourquoi il n'a plus les photos approprié .
mais l'écrit n'étant pas effacer ,j'ai revue mon blog en entier voilà pourquoi je l'ai remis car j'avais la flemme de réfléchir .

 45 commentaires
45 commentaires
-
Par Harmonie32 le 6 Octobre 2020 à 18:19
Avantages et inconvénients
Pour ma part, je trouve les commentaires indispensables à un article sur un blog et ce pour plusieurs raisons :
Personne n'est parfait et on a toujours pu oublier quelque chose dans l'article qu'on écrit. Une personne extérieure peut donc plus ou moins corriger ce qu'on a écrit.Certaines personnes peuvent avoir besoin de précisions sur certains points. Là encore, on a très bien pu mal s'exprimer ou expliquer certaines choses de façon maladroite et les demandes d'éclaircissement sont légitimes.En revanche, les commentaires ont également des côtés plus sombres et difficile .Pourrissement égoïste et quasi-systématique de ces commentaires par des bourrins qui n'ont pour seule idée que celle de gangrener notre site avec des commentaires bidons à gérer ,la discussion et le partage d'opinions restent pour moi indispensables au débat d'idées, c'est même l'une de mes motivations principales pour l'écriture quotidienne d'articles.Laisser un commentaire sur un blog c’est important pour le blog Je pense qu’il faut laisser les commentaires sur les blogs, cela permet les débats, les échanges d’opinions Je parle bien évidement des vrais commentaires qui ont du sens qui vont avec l'article écrit,mais juste un bonjour comment tu vas ,c'est très bien aussi ,mais à la fin ou au début du commentaire .Maintenant n'hésitez pas à poster vos commentaires pour dire ce que vous pensez de tout ça .

 9 commentaires
9 commentaires
-
Par Harmonie32 le 5 Juillet 2020 à 18:30
samedi ,nous avons ramené ma mère , après un mini séjour à l'Hôpital pour nous dire que tout allait bien ' sauf nutrition ,'six semaine chez nous ou je l'ai obligé de manger tout ses repas sans en laissé une miette , était très contente d'être chez elle , de retrouvé ses repères car elle avait oublié comment était sa maison ,a passé une bonne nuit .
*********************************************************************************************************

 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Harmonie32 le 10 Juin 2020 à 20:32
Ma mère et moi nous sommes allées à la boucherie et au marché ,la navette de la ville nous a déposé ,puis nous avons marcher beaucoup, ben oui , elle a eu sa dose, dès qu'ont est rentré ma mère qui fait toujours la forte s'est écroulé dans le fauteuil et ouiii elle a dormi , une micro sieste ,après le repas du midi ,pendant qu'elle écossait les petits pois et que mon mari fessait sa sieste je me suis éclipsé chez ma copine pour lui ramené deux salade de mon jardin
Ces photos c'est l'espace jardin de mon amie ,vous savez celle qui est revenue du Sud qui était partie sept années du Haut de France
*********************************************************************

 9 commentaires
9 commentaires
-
Par Harmonie32 le 5 Juin 2020 à 06:12
Jeudi ,Bonne journée avec ma mère ,le matin nous sommes allées en ville ,l'après midi elle a fait une toute petite sieste, pendant que je débarrassais la table du diner ,puis nous avons regardé une série de six épisode (histoire vrais meurtre a " WIHITE HOUSSE FARM ''ma mère a regardé jusqu'au bout elle s'est intéressé a l'histoire sans rien oublié encore un épisode de la fin a regardé ,enfin elle avait toute sa tête .A voir absolument très prenant je l'avais déjà vu mais comme je voulais qu'elle le voit aussi ,en tout cas j'ai bien bien fait car elle était clair dans sa tête .
Tout commence la nuit du 6 août 1985, lorsque 5 personnes sont tuées à la White House Farm. Les victimes sont les parents Nevill et June Bamber, leur fille adoptive Sheila Caffell et ses deux fils, Daniel et Nicholas. Le seul membre de la famille survivant est Jeremy Bamber, fils adoptif de Nevill et June, alTout commence la nuit du 6 août 1985, lorsque 5 personnes sont tuées à la White House Farm. Les victimes sont les parents Nevill et June Bamber, leur fille adoptive Sheila Caffell et ses deux fils, Daniel et Nicholas. Le seul membre de la famille survivant est Jeremy Bamber, fils adoptif de Nevill et June, alors âgé de 24 ans.ors âgé de 24 ans.
Les enquêteurs soupçonnent au départ Sheila, souffrant de schizophrénie, d’être responsable des meurtres avant d’avoir mis fin à ses jours. Cependant, un autre suspect va émerger dans toute cette histoire .
Cette mini série histoire vrais est en replay jusqu'au 15 septembre.A regardé absolument .

 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Harmonie32 le 13 Mai 2020 à 21:00
pas quoi décidé pour notre mère ;elle a été trop longtemps seule, vu l'épidémie du coronavirus ,elle perd la notion ,j'ai envoyé des messages a mes deux sœurs ,Tina la plus jeune m'a répondu ,mais je pense qu'elle est a côté de la plaque et Helga la plus âgée pas de réponse ,en faite je crois que toute les deux s'en fiche ,si je prend notre mère chez moi ,ce sera difficile pour moi ,si je la mets en maison de retraite je vais m'en vouloir .La ...je réfléchie depuis lundi mais je ne sais pas prendre une décision (mème si mon mari accepte qu'elle vienne chez nous ,)en faite il s'en fiche car ce n'est pas lui qui va s'occupé d'elle ..Aller chez elle!!!!! mais la !!!!!je m'enterrerais vivante ,car il n'y a rien a faire a part mourir a petit feu .Plus de vie !!!!!!!!!!!!plus d'amies.
Pour mes sœurs ce serait un frein à leur vie d’égoïstement, elles trouvent toujours des excuses .
hier matin j'ai eu au téléphone ma sœur ainée qui me donnait des conseils ,"si maman reste chez elle et si et si ....si elle va en maison de retraite elle sera perdu car elle ne connait personnes ,et si elle est chez toi ça serait mieux , mais moi je ne peux pas mon mari ceci, moi cela ça me fait rire son mari a dix ans de moins qu'elle ". elle m'aurait dit chacun son tour, trois mois chacune (nous sommes trois ) j'aurais compris donc pour elle , c'est moi qui doit prendre une décision .
En plus notre mère n'en fait qu'a sa tête quand je lui est parlé au tél hier ,elle me disait ce qu'elle allait faire dans la journée ,je lui répondais ce n'est pas la peine la ou tu veux allée c'est fermer ou il faut prendre rendez vous ,comme ,je ne ne dis pas ce qu'elle veut entendre , elle me raccroche .Dur dur une égoïste comme ma sœur ainée .
Les IRIS cueilli hier soir
Il est 11H 10 ce jour le 14 mai 2020
Retour de carrefour marché à vélo j'ai pu réfléchir dans le froid ,oui c'est glacial dehors avec du soleil et ciel bleu , mais sa fait du bien .
Je ne dois pas me sacrifié je le sais 'choco 'a raison mais je crois que ...j'ai trop mal au cœur de la laissé comme ça ,en plus tous mes enfants disent qu'il ne faut pas la mettre en maison de retraite .
Je prendrais ma décision en fin de semaine .

 8 commentaires
8 commentaires
-
Par Harmonie32 le 1 Mai 2020 à 06:29
le muguet est-il une plante toxique ?
Les clochettes du muguet ne manquent pas de séduire chaque année mais faire entrer la fleur du 1er mai dans nos intérieurs n'est pas sans risque parce qu'elle renferme de la convallarine, une substance très toxique. Il vous faudra donc être vigilant si vous achetez un brin de muguet ou un bouquet. Ne laissez ainsi jamais les bébés et jeunes enfants jouer avec du muguet et appelez tout de suite un centre antipoison si malgré votre vigilance votre enfant a mâchouillé un brin de muguet. Vous devrez également être particulièrement vigilant si vous possédez des animaux de compagnie car l'ingestion peut provoquer une intoxication mortelle. Sachez que la totalité de la plante est toxique et même l'eau du vase. Veillez donc à placer vos brins de muguet dans un endroit inaccessible pour les chats, chiens et autres compagnons.
Pourquoi le muguet est-il une plante porte bonheur ?
Savez-vous pourquoi le muguet est à l'honneur le jour de la Fête du travail ? Si la fleur à clochettes blanches est vendue le 1er mai, c'est d'abord une question de tradition qui remonte à 1561. Charles IX, qui avait reçu un brin à cette date, décida d'en offrir aux dames de la cour chaque année. Puis la tradition est devenue réellement populaire en 1900 où le muguet se retrouva au centre d'une fête organisée par les couturiers parisiens le 1er mai. Dans le langage des fleurs, le muguet est un porte-bonheur depuis le Moyen-Age, tout simplement parce qu'il symbolise le retour du printemps et annonce les beaux jours. Mai était aussi le mois des mariages et les fiancés accrochaient un bouquet de muguet à la porte de leur future épouse. Lorsque vous recevrez ou offrirez du muguet, comptez le nombre de clochettes : s'il y en a 13, c'est un symbole de félicité éternelle !

 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Harmonie32 le 30 Avril 2020 à 06:08
Vous savez dans toute les religions il y a les mème écrit,Dieu" , a dit ses commandement ,si les humains auraient suivi , aujourd'hui il n'y aurait pas d"épidémie .(EXEMPLE ,vous dite a votre enfant ne touche pas la plaque de gaz , sinon tu vas te bruler, vous avez a peine le dos tourner que vous entendez un hurlement , l'enfant s'est bruler car il vous a désobéi .Vous dites a votre enfant de ne pas traversé la route, il vous désobéi trop tard, le mal est fait .Aujourd'hui c'est exactement pareil avec l'épidémie le' coronavirus' ,l'être humains était prévenu , mais ils s'en fiche ,il n'y a que l'argent qui compte .Une ville j'aurais compris ,ce n'est pas grave mème si ça l'est, mais c'est le monde entier qui est concerné ,ce n'est pas une personne qui meure chaque jour, chaque nuit ,mais des milliers d'être humains.Et oui on doit suivre à la lettre les commandements de " Dieu ' et non faire le contraire , car aujourd'hui le monde entier n'en serait pas là ou nous en sommes actuellement .En tout cas ce sont mes pensées .(Mème les religions font ce qu'ils veulent, ils font semblant de suivre mais disent et font le contraire , ils n'apprennent rien et n’approfondirent rien ,ils se batte que pour l'argent ,mais il y a bien une vérité quelques part tout n'est pas venu tous seul sur cette terre que le monde détruit a petit feu .
A MÉDITÉ

 9 commentaires
9 commentaires
-
Par Harmonie32 le 2 Avril 2020 à 10:28
a commencé par des guerres d'ailleurs ici et la , ça continu toujours de par le monde .
L'être humains est assoiffé d'argent.
Des tremblement de terre ici et la.
Il y a eu des tsunami ,ces vague gigantesques ont souvent semé la mort et la destruction des port et des villages côtiers japonais
Dernièrement le feu de forêt qui a tout détruit en Australie. Une surface équivalente à la Corée du Sud est partie en fumée, 28 personnes et plus d'un milliard d'animaux ont été tués et des milliers de bâtiments détruits.
Selon la Commission mondiale d’étude de l’environnement et du développement, les actuels problèmes environnementaux affectent à ce point notre planète qu’ils mettent la vie de l’humanité en danger. Au cours des 900 jours qui ont suivi la première réunion de cette commission, 60 millions d’enfants sont morts de maladies liées à la malnutrition et à la consommation d’eau contaminée. La sécheresse en Afrique a fait un million de victimes supplémentaires. Des catastrophes industrielles comme celles de Bhopâl, en Inde, et de Tchernobyl, en Union soviétique, ont coûté la vie à 3 000 personnes et en ont touché des millions d’autres. Quelles sont les prévisions pour les 30 prochaines années? D’après le Times de Londres, une surface de terres arables équivalant à celle de l’Arabie saoudite est promise à la désertification, et une zone forestière de la taille de l’Inde est appelée à disparaître. Pour cette commission nommée par les Nations unies, “il est urgent d’entreprendre une action internationale vigoureuse” si l’on veut assurer la survie de l’humanité.
Tchernobyl qui a donner des malformation aux enfants et femme enceinte
Les pires épidémies que le monde ait connues
Peste, choléra, variole....
Le choléra est une infection intestinale provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Il provoque de violentes diarrhées, parfois accompagnées de vomissements.
Aujourd'hui l'épidémie du coronavirus est mondial !!!!!!!!!
Que pensez vous de tout ce qui arrive ,avant c'était ailleurs ,autre pays ,les média en parlait à la télévision à la radio depuis des mois des années ,mais ont s'en en fichaient complètement ont avaient mal au cœur pour ses gens cinq minutes ,et ont oubliaient car ont à la belle vie en Europe ,en Amérique , mais aujourd'hui ça nous arrive aussi , c'est mondial .Toute les religions bien suivi le proclame ,ainsi que Nostradamus depuis des années ça a été dit que sa arriverait.
Les prédictions Nostradamus!!! 2020 ne présagent rien de bon pour l’année. De nombreux événements catastrophiques se produiront jusqu’en 2025 avant que la paix revienne dans le monde.
Quand pensez vous ? de tout ceux qui arrive et qui arrivera encore dans l'avenir .Pas le top c'est sur ..Il est temps que le monde réfléchissent a son égoîsterie,beaucoup de personne vivent leur vie ils cherche leur satisfaction personnel ,ils ne pensent qu'a se remplir les poche et s'en fiche du monde entier ,certain pense, parce qu'ils sont blanc ils sont mieux que les noirs ou les asiatiques ou les indiens ou les arabes ,toute les nationalité du monde , mais nous sommes tous des humains et nous avons le droit de vivre bien sur cette terre nous ne sommes pas mieux qu'eux .
Je sais ce n'est pas nous qui gouvernons mais nous y contribuons .

 13 commentaires
13 commentaires
-
Par Harmonie32 le 5 Janvier 2020 à 06:29
Est-ce que vous connaissez des personnes qui ne sont jamais contentes . Je ne crois pas me tromper si je dis qu’il y en a plusieurs dans votre entourage. Essayer de leur offrir un bouquet de roses, elles vous parlent des épines dis que sa porte malheur si elles se pique , elles nous entraînent dans une spirale sans se rendre compte que nous essayons de nous plier en quatre en leur parlant gentillement en leur écrivant des beau commentaires sur leur blog pour qu'elles réfléchissent ,NON ..elles ne veulent pas réfléchir , ce sont des personnes qui pense avoir raison sur tout et ça continu de jour en jours et de pire en pire ,bizarre chaque jour ils leur arrive un truc ,jamais contente encore ce matin . Je crois qu'elles crée ses histoires lamentable c'est pour cette raison quelles sont mal dans leur corps. Mais parmi les " jamais content " que je rencontre dans la vie ou sur les blogs surtout sur les blog , ses personnes sont toujours insatisfaites quoi qu’elles fassent ou quoi que l’on fasse pour elles. Il y a toujours quelque chose à reprocher pas assez ceci, trop cela. Elles culpabilisent leurs proches qui sont incapables de la satisfaire . Dans certain blog que j'ai pu lire ce ne sont pas les enfants devenu adulte qui sont toxique mais bien souvent 'c'est la maman ' qui n'est jamais contente de voir leur enfants heureux car ce n'est plus elle qui gère leur vie .Mais ses personne son maladive et ne se rende pas compte de leur problème , après elles se demande pourquoi leur enfants ne viennent jamais les voir avec leur petits enfants ,et même ne plus les fréquenté. Moi ,par exemple; je fais tout pour tous le monde, je le fais de bon cœur, je donne sans arrière pensée et sans retour de quoi que ce soit ,c'est comme ça que j'ai des cadeaux qui sont toujours des surprises.Mes enfants n'ont pas besoin de m'appeler pour venir chez nous, ils viennent quand ils veulent ,si nous ne sommes pas la ,ils ont tous une clef de la maison .Et si je suis la, le diner sera servi pour tout le monde mème si c'est des spaghetti à la bolognaise vite fait bien' fait maison '. En vérité chaque enfants devenu adulte mariés ou pas, ont leur vie avec leur enfants , leur amis (es) ,nous nous sommes les parents, on ne rentre pas dans leur vie quand ils sont avec leur amis(es) ça ne se fait pas ,nous avons eu notre temps pas vrais . La vie est ce qu'on en fait ,vous devrez mesurer votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive .
' Une tête de jamais content'
" pauvre ours en peluche "

 13 commentaires
13 commentaires
-
Par Harmonie32 le 24 Décembre 2019 à 05:27
Voici mon chat jaloux, qui a pris la place de Milhan dans le lit parapluie,que j'ai installé dans le salon pour le surveillé de prêt car bébé bouge beaucoup j'ai mise des petits coussins pour que mon chat ne prenne pas la place sur les drap ,mais il s'y est installé quand mème .

 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Harmonie32 le 8 Décembre 2019 à 20:50
la ramené ,Ma mère se retrouve seule, elle pleurais hier soir au téléphone ,Que faire retourné la chercher,ou attendre encore un peu ,j'ai beau écrire des messages à mes deux sœurs ,pas de réponse ,notre mère voudrait entendre leur voix mème si elles ne veulent pas venir la voir ,je vais essayé de lui trouver un logement pas loin de chez moi comme ça elle aura ses meubles ce sera beaucoup mieux que une chambre chez moi .Ma mère est très maligne ,elle voudrait que je jette mes meubles pour mettre les siens à la place ,donc c'est moi qui ne sera plus chez moi ,très très difficile de gérer tout ça ,en faite je ne sais plus quoi faire vu son age ,et que mes sœurs sans cœur ne me réponde pas .

 10 commentaires
10 commentaires
-
Par Harmonie32 le 17 Octobre 2019 à 15:00
Enfin tranquille hier soir ,j'ai regardé sur la Arte ( Lady Chatterley ) avec Marina Hands ,Jean- Louis Coulloc'h
Date de sorti 1 Novembre 2006.En repay sur la Arte jusqu'au 23 octobre 2019.
En 1921, dans la froideur du château des Chatterley, la jeune Constance s'ennuie auprès de son mari, sir Clifford, infirme depuis son retour de la Grande Guerre. Les époux font chambre à part et leur vie reculée est très monotone. Constance, dévouée, souffre de cette situation. Fatiguée, elle cède sa place d'aidante auprès de son mari au profit d'une garde-malade. Un jour, elle rencontre Parkin, le garde-chasse, un homme bourru et solitaire. Ces deux êtres, séparés par leur position sociale, vont peu à peu se rejoindre dans un éveil des sens salvateur.
Portée par une interprétation d'une grande finesse, une magnifique et audacieuse adaptation du roman de D.H. Lawrence.
A voir les filles , vous ne perdrez pas votre temps croyez moi, trop bien ce film ..

 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Harmonie32 le 19 Septembre 2019 à 22:59
Je suis a Alger depuis vendredi dernier,6 jours aujourd'hui , et 9 ans que je n'avais pas été dans ce pays ,j'ai remis a jour la décoration de ma cuisine .Le reste comme les chambres, la salle de bain, couloir toilette étant refait par des pros (maison de star ) rire ...... Je suis déjà allée au super marché carrefour et au super marché Aridis (Auchan) qu'il n'avait pas ,il y a encore quelques années "L'Algérie n'a rien a envier à la France ni aux français."J'ai remplie mon cadis avec ceux que j'avais besoin j'en ai eu pour 20 euros en France j'aurais payer 60 euros .Bien sur avec l'argent du pays 'Dinars 'mais c'est très dur pour certaine personne qui vivent ici.Moi je prenais des petits suisse au fruit le bloc entier ,des gens n'en prennent que un car ils peuvent les prendre séparément ceux qui n'est pas autorisé en France .
Manifestation depuis décembre dernier tous les vendredi ,"pas de casse de magasins ,pas de vol ,pas de voiture brûler ,disons pas un œuf de cassé .Les Algériens du pays savent ce qu'ils veulent ,et savent que ça ne fonctionne pas en cassant et en brûlant les voitures
En plus ils nettoie les rues en manifestant ,pas un papier par terre .
Pour les photos il faudra attendre car mon ordinateur que j'ai ici n'est pas a jour je galère le réseau laisse a désiré aussi .
A bientôt tous le monde
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par Harmonie32 le 13 Juin 2019 à 14:34
Le buddleia est un arbuste à fleurs originaire de Chine et d'Himalaya. Certaines espèces moins communes proviennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud. Il peut atteindre 4 m de hauteur et accepte tous les types de sols même difficiles.Pour que cet arbuste fleurisse bien il a besoin de bonne lumière et de soleil au moins 4 heures par jour et les papillons seront plus nombreux. Le pic de floraison des buddléias a lieu en Juin - Juillet mais, si l'on prend la peine de tailler les fleurs fanées, on obtient une seconde floraison d'Août à Septembre.En plantant un Buddléia, vous avez des chances de voir dans votre jardin de superbes papillons dont le spectaculaire Vulcain (Red Admiral).

 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Harmonie32 le 26 Mai 2019 à 20:13
MICHELLE OBAMA .
À tous ceux qui m’ont aidée à devenir :
les membres de ma famille qui m’ont élevée,
Fraser, Marian, Craig, et ma grande famille élargie ;
mon cercle de femmes puissantes, qui nourrissent mon optimisme ;
mon équipe loyale et dévouée, qui continue de faire ma fierté.
________
Aux amours de ma vie :
Malia et Sasha, mes deux trésors les plus précieux,
qui sont ma raison d’être ;
et, enfin, Barack, qui m’a toujours promis un voyage intéressant.Michelle Obama s’est imposée, au cours d’un parcours exemplaire, comme l’une des figures les plus remarquables de notre époque. Devenir retrace le parcours intime d’une femme de caractère qui a toujours su aller au-delà de ce qu’on attendait d’elle – une histoire qui nous encourage à faire de même.
Préface Mars 2017 ***********************************************
À tous ceux qui m’ont aidée à devenir : les membres de ma famille qui m’ont élevée, Fraser, Marian, Craig, et ma grande famille élargie ; mon cercle de femmes puissantes, qui nourrissent mon optimisme ; mon équipe loyale et dévouée, qui continue de faire ma fierté. ________ Aux amours de ma vie : Malia et Sasha, mes deux trésors les plus précieux, qui sont ma raison d’être ;
Quand j’étais petite, mes désirs étaient simples. Je voulais un chien. Je voulais une maison avec des escaliers – deux étages pour une seule famille. Je voulais, allez savoir pourquoi, un break à quatre portières à la place de la Buick deux portes qui faisait la joie et l’orgueil de mon père. Je disais à qui voulait l’entendre que, quand je serais grande, je serais pédiatre. Pourquoi ce choix ? Parce que j’aimais bien les enfants et que j’avais rapidement compris que c’était une réponse qui plaisait aux adultes. Oh, médecin ! Quelle bonne idée ! En ce temps-là, j’avais des nattes, je menais mon grand frère à la baguette et je me débrouillais toujours pour avoir de bonnes notes en classe. J’étais ambitieuse, sans vraiment savoir à quoi j’aspirais. Je crois d’ailleurs que c’est une des questions les plus bêtes qu’un adulte puisse poser à un enfant : Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Comme si on cessait un jour de grandir. Comme si, à un moment donné, on devenait définitivement quelqu’un, et qu’alors tout devait s’arrêter.
À ce jour, j’ai été avocate. J’ai été vice-présidente d’un hôpital et directrice d’une association qui aide les jeunes à s’engager dans des carrières sérieuses. J’ai été une jeune fille noire d’origine modeste, étudiante dans une université prestigieuse fréquentée majoritairement par des Blancs. J’ai été la seule femme, la seule Afro-américaine, dans beaucoup de contextes différents. J’ai été une épouse, une jeune maman stressée, une fille affligée. Et, jusqu’à une date récente, j’ai été avocate. J’ai été vice-présidente d’un hôpital et directrice d’une association qui aide les jeunes à s’engager dans des carrières sérieuses. J’ai été une jeune fille noire d’origine modeste, étudiante dans une université prestigieuse fréquentée majoritairement par des Blancs. J’ai été la seule femme, la seule Afro-américaine, dans beaucoup de contextes différents. J’ai été une épouse, une jeune maman stressée, une fille affligée. Et, jusqu’à une date récente, j’ai été première dame des États-Unis d’Amérique – un métier qui n’en est pas un officiellement, mais qui m’a offert une tribune dont je n’aurais jamais pu rêver. Ce métier m’a mise au défi et m’a appris l’humilité, m’a exaltée et abattue, parfois tout cela en même temps. Je commence à peine à assimiler ce qui s’est passé au cours de ces dernières années – entre le moment, en 2006, où mon mari a évoqué pour la première fois l’idée de se présenter à la présidence et le froid matin d’hiver où je suis montée à bord d’une limousine avec Melania Trump pour l’accompagner à l’investiture de son mari. Quel voyage !
Quand on est première dame, l’Amérique se révèle à vous dans tous ses extrêmes. J’ai participé à des collectes de fonds dans des demeures particulières qui ressemblaient à des musées, dans des maisons où les baignoires étaient faites de pierres précieuses. Je suis allée voir des familles qui avaient tout perdu à cause de l’ouragan Katrina, et qui pleuraient de reconnaissance simplement parce qu’elles avaient un réfrigérateur et une cuisinière en état de marche. J’ai fait la connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais aussi de personnes – des enseignants, des femmes de militaires et tant d’autres – qui m’ont éblouie par la profondeur et la solidité de leur détermination. Et j’ai rencontré des enfants – de très nombreux enfants, dans le monde entier – qui m’ont fait mourir de rire, m’ont emplie d’espoir, et ont réussi pour mon bonheur à oublier mon titre dès que nous avons commencé à retourner ensemble la terre d’un jardin.
Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, j’ai été considérée comme la femme la plus puissante du monde et dénigrée comme une « femme noire en colère ». J’ai eu envie de demander à mes détracteurs à quel élément de cette formule ils accordaient le plus de poids – « en colère », « noire » ou « femme » ? Je me suisforcée à sourire quand on m’a photographiée avec des gens qui traitaient mon mari de tous les noms à la télévision, mais n’en tenaient pas moins à avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m’a rapporté qu’il y avait sur Internet des commentaires nauséabonds me concernant, certains allant même jusqu’à douter que je sois bien une femme et non un homme. Un membre du Congrès américain s’est moqué de mes fesses. J’ai été en colère. Mais, le plus souvent, j’ai préféré en rire.
Il y a encore tant de choses que j’ignore au sujet de l’Amérique, de la vie, et de ce que l’avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m’a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m’ont aidée à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l’histoire de notre pays. Même quand elle est loin d’être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l’auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer.
J’ai passé huit ans à la Maison-Blanche, où il y a plus d’escaliers que je n’en saurais compter – sans parler des ascenseurs, du bowling et du fleuriste. J’ai dormi dans des draps italiens, pris des repas préparés par une équipe de chefs de renommée internationale et servis par des professionnels mieux formés que le personnel de n’importe quel restaurant ou hôtel cinq étoiles. Des agents impassibles du Secret Service montaient la garde devant notre porte avec leur arme et leur oreillette, en s’employant à empiéter le moins possible sur la vie privée de notre famille. Nous avons fini par nous habituer à tout cela – à l’étrange magnificence de notre nouveau foyer et à la présence constante, silencieuse, d’étrangers.
C’est à la Maison-Blanche que nos deux filles ont joué au ballon dans les couloirs et grimpé aux arbres de la pelouse sud. C’est là que Barack a veillé tard le soir, penché sur des dossiers et des ébauches de discours dans la salle des Traités, là aussi qu’il est arrivé à Sunny, un de nos chiens, de s’oublier sur un tapis. Du balcon Truman, je pouvais voir les touristes se prendre en photo avec leurs perches à selfies et jeter un coup d’œil à travers la grille en fer forgé, cherchant à deviner ce qui se passait à l’intérieur. Tantôt, toutes ces fenêtres fermées par mesure de sécurité et l’impossibilité de respirer un peu d’air frais sans que cela fasse toute une histoire m’étouffaient. Tantôt, les magnolias blancs en fleur au-dehors, l’effervescence quotidienne des affaires du gouvernement ou la majesté d’une cérémonie militaire m’émerveillaient. Il y a eu des jours, des semaines, des mois où j’ai détesté la politique. Et il y a eu des moments où la beauté de ce pays et de ce peuple m’a laissée muette d’admiration.
Et puis ça s’est terminé. On a beau la voir venir au long des dernières semaines pleines d’au revoir plus émouvants les uns que les autres, cette dernière journée se déroule dans une sorte de brouillard. Une main se pose sur une bible ; un serment est répété. Les meubles d’un président sont emportés tandis que ceux d’un autre arrivent. Les placards sont vidés et remplis en l’espace de quelques heures. Du jour au lendemain, de nouvelles têtes viennent se poser sur de nouveaux oreillers – d’autres personnalités, d’autres rêves. Et quand tout cela s’achève, quand vous franchissez pour la dernière fois la porte de la maison la plus célèbre du monde, il vous reste, à bien des égards, à vous retrouver.
Permettez-moi de commencer ici par une petite anecdote récente. J’étais chez moi, dans la maison de brique rouge où ma famille a récemment emménagé et qui est située à environ trois kilomètres de notre ancienne demeure, dans une rue d’un quartier paisible. Nous étions encore en train de prendre nos marques. Dans le salon, nos meubles sont disposés comme ils l’étaient à la Maison-Blanche. De la cave au grenier, des souvenirs nous rappellent que cela a réellement en lieu – des photos de notre famille à Camp David, des pots modelés à la main que m’ont donnés des étudiants amérindiens, un livre dédicacé par Nelson Mandela. Ce soir-là, il n’y avait que moi à la maison, ce qui était inhabituel. Barack était en voyage. Sasha était sortie avec des amis. Malia vivait et travaillait à New York, où elle terminait son année de césure avant d’entrer à l’université. J’étais seule avec nos deux chiens dans une maison vide et silencieuse comme je n’en avais pas connu depuis huit ans.
J’avais faim. Je suis sortie de notre chambre, j’ai descendu l’escalier, les chiens sur les talons. Dans la cuisine, j’ai ouvert le frigo. J’ai trouvé du pain, j’en ai pris deux tranches que j’ai glissées dans le grille-pain. J’ai ouvert un placard et j’ai sorti une assiette. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais prendre une assiette sur une étagère sans que quelqu’un insiste pour le faire à ma place, regarder paisiblement le pain dorer dans le grille-pain, était ce qui se rapprochait le plus d’un retour à ma vie d’avant. Ou peut-être était-ce l’annonce du début de ma nouvelle vie.
Finalement, je ne me suis pas contentée de me faire griller du pain. Je me suis préparé un sandwich au fromage : j’ai mis un gros morceau de cheddar entre mes deux toasts et j’ai placé le tout au micro-ondes. Puis j’ai pris mon assiette et je suis sortie dans le jardin. Je n’ai pas eu à prévenir qui que ce soit. Je suis sortie, un point c’est tout. J’étais pieds nus, en short. Le froid de l’hiver avait enfin cédé. Les crocus pointaient leur nez dans les plates-bandes, le long du mur du fond. L’air sentait le printemps. Je me suis assise sur les marches de la véranda, sentant sous mes pieds la chaleur du soleil de la journée qu’avait accumulée le pavage en ardoise. Un chien a aboyé au loin, et les miens ont tendu l’oreille, un temps désorientés. Je me suis rendu compte que ce bruit devait les troubler, car nous n’avions pas de voisins à la Maison-Blanche, et encore moins de chiens des voisins. Tout cela était nouveau pour eux. Alors qu’ils faisaient le tour du jardin, j’ai mangé mon sandwich dans l’obscurité, me sentant aussi délicieusement seule qu’il est possible. Je ne pensais pas au groupe de gardes armés qui se trouvait à moins de cent mètres de moi, dans le poste de commandement aménagé dans notre garage, ni au fait qu’il ne m’était toujours pas possible de me promener dans la rue sans gardes du corps. Je n’ai pas songé au nouveau président ni, d’ailleurs, à l’ancien.
Je me suis simplement dit que, quelques minutes plus tard, j’allais rentrer dans ma maison, laver mon assiette dans l’évier et monter me coucher. Peut-être ouvrirais-je une fenêtre pour laisser entrer l’air printanier – quelle volupté ! Je me suis dit aussi que ce calme m’offrait la première véritable occasion de prendre du recul et de réfléchir. Quand j’étais première dame et que je parvenais au terme d’une semaine trépidante, j’avais besoin qu’on me rappelle comment elle avait débuté. Mon appréciation du temps commence cependant à changer. Mes filles, qui ont emménagé à la Maison-Blanche avec leurs Polly Pockets, un doudou baptisé Blankie et un tigre en peluche appelé Tiger, sont à présent des adolescentes, des jeunes femmes avec chacune leurs projets et leur voix pour se faire entendre. Mon mari s’adapte à sa vie d’après la Maison-Blanche, il reprend son souffle. Et me voilà, moi, dans cette nouvelle maison, avec tant de choses à dire.Il y a une suite un livre très intéressant
SUITE

 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Harmonie32 le 26 Mai 2019 à 20:12
J’ai passé une grande partie de mon enfance à écouter le son de l’effort. Il parvenait à mes oreilles à travers le plancher de ma chambre sous forme de mauvaise musique, ou plus exactement de musique d’amateur – le plonk plonk plonk des élèves assis un étage plus bas devant le piano de ma grand-tante Robbie, apprenant leurs gammes lentement et laborieusement. Ma famille vivait à Chicago dans le quartier du South Side, dans un coquet pavillon de brique appartenant à Robbie et à son mari, Terry. Mes parents louaient un appartement au premier étage, tandis que Robbie et Terry occupaient le rez-de-chaussée. Robbie était la tante de ma mère et avait été très généreuse avec elle pendant de longues années, mais elle me terrorisait un peu. Guindée et sérieuse, elle dirigeait la chorale d’une église locale tout en étant le professeur de piano attitré du voisinage. Elle portait des chaussures à petits talons et des lunettes au bout d’une chaîne passée autour du cou. Elle avait un sourire espiègle, mais n’aimait pas l’esprit sarcastique qu’affectionnait ma mère. Il m’arrivait de l’entendre houspiller les élèves qui n’avaient pas assez travaillé ou les parents qui les avaient déposés en retard à leur leçon.
« Bonne nuit ! » s’écriait-elle en plein jour, avec l’exaspération volcanique qu’un autre aurait pu mettre dans « Bon sang de bonsoir ! » Peu de gens, semblait-il, étaient à la hauteur des attentes de Robbie.
L’écho produit par des élèves qui s’efforçaient d’apprendre constituait le fond sonore de notre vie. Ça pianotait l’après-midi, ça pianotait dans la soirée. Des dames de l’église venaient quelquefois répéter des cantiques, bramant leur piété à travers nos murs. En vertu des règles de Robbie, les enfants qui prenaient des cours de piano n’étaient autorisés à travailler qu’un morceau à la fois. Depuis ma chambre, je les entendais s’évertuer, note par note, non sans errements,
à obtenir son approbation, passant, au fil de leurs progrès et au terme de nombreuses tentatives, de comptines comme Hot Cross Buns à la Berceuse de Brahms. La musique n’était jamais agaçante ; simplement persistante. Elle se glissait dans la cage d’escalier qui séparait notre logement de celui de Robbie. Elle s’insinuait par les fenêtres ouvertes l’été, accompagnant mes pensées pendant que je jouais à la Barbie ou empilais mes cubes pour construire de petits royaumes. Nous ne connaissions de répit que quand mon père rentrait tôt de la station municipale d’épuration des eaux où il travaillait et allumait la télé pour regarder un match de base-ball des Cubs, montant le son assez fort pour couvrir les autres bruits.
C’était la fin des années 1960 dans le South Side de Chicago. Les Cubs n’étaient pas mauvais, mais ils n’avaient rien d’exceptionnel non plus. Blottie sur les genoux de mon papa assis dans son fauteuil relax, je l’écoutais dire que les Cubs connaissaient une baisse de régime en cette fin de saison ou expliquer pourquoi Billy Williams, qui vivait juste au bout de la rue sur Constance Avenue, était capable de réaliser des frappes incroyables depuis la gauche du marbre. Hors des stades de base-ball, l’Amérique était en plein changement – un changement aussi massif qu’incertain. Les Kennedy étaient morts. Martin Luther King avait été tué sur un balcon de Memphis, un assassinat qui avait provoqué des émeutes dans tout le pays, y compris à Chicago. À la convention nationale démocrate de 1968, le sang avait coulé quand la police s’en était prise à coups de matraque et de gaz lacrymogène aux manifestants qui protestaient contre la guerre du Vietnam à Grant Park, à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Dans le même temps, des familles blanches quittaient la ville en masse, attirées par les banlieues – par la promesse de meilleures écoles, de plus d’espace, de plus de blancheur aussi, sans doute.
Tout ça me passait largement au-dessus de la tête. Je n’étais qu’une gamine qui jouait à la Barbie et aux cubes. J’avais un père, une mère, et un frère aîné dont la tête, toutes les nuits, reposait à moins d’un mètre de la mienne. Ma famille représentait tout mon univers, c’était le centre de tout. Ma mère m’a appris à lire tôt : elle m’accompagnait à la bibliothèque publique et s’asseyait à côté de moi pendant que je déchiffrais tout haut des mots sur une page. Mon père partait travailler tous les matins dans son uniforme bleu d’employé municipal, mais, le soir, il nous transmettait son amour du jazz et de l’art. Il avait suivi des cours à l’Art Institute de Chicago quand il était petit, et pris des cours de peinture et de sculpture au lycée. À l’école, il avait participé à des compétitions de natation et de boxe, et, devenu adulte, il adorait tous les sports qui passaient à la télé, du golf professionnel au hockey. Il aimait voir des gens très forts se surpasser. Quand mon frère s’est pris de passion pour le basket, mon père s’est mis à poser des pièces de monnaie au-dessus du montant de la porte de la cuisine, et l’encourageait à sauter pour les attraper.
Tout ce qui comptait pour moi se trouvait dans un rayon de cinq rues – mes grands-parents et mes cousins, l’église du coin où nous n’allions pas très régulièrement au catéchisme, la station-service où ma mère m’envoyait parfois chercher un paquet de cigarettes, et le magasin d’alcool, qui vendait aussi du pain de mie, des bonbons et du lait. Par les chaudes soirées d’été, nous nous endormions, mon frère et moi, au son des acclamations qui scandaient les matchs senior de softball dans le parc public voisin, où, dans la journée, nous grimpions sur les agrès de l’aire de jeux et jouions à chat avec les autres gamins.
Nous n’avons pas tout à fait deux ans d’écart, Craig et moi. Il a les yeux doux et l’optimisme de mon père, l’inflexibilité de ma mère. Nous avons toujours été très proches, en partie grâce à l’allégeance inébranlable et quelque peu inexplicable qu’il a vouée d’emblée à sa petite sœur. Il existe une vieille photo en noir et blanc de nous quatre assis sur un canapé, ma mère souriante et mon père, fier et sérieux, nous tenant Craig et moi sur leurs genoux. Nous sommes habillés pour aller à l’église, ou peut-être à un mariage. Je dois avoir huit mois, une armoire à glace en couche-culotte et au visage grassouillet, la mine résolue, apparemment prête à échapper à ma mère, les yeux rivés sur l’appareil photo comme si j’allais me jeter dessus. Craig est à côté de moi, un vrai petit monsieur en veston et nœud papillon, l’air grave. Du haut de ses 2 ans seulement, il est déjà l’incarnation du grand frère vigilant et responsable – le bras tendu vers le mien, ses doigts entourant mon poignet dodu dans un geste protecteur.
Quand cette photo a été prise, nous vivions en face de chez les parents de mon père, de l’autre côté du couloir, à Parkway Gardens, un grand ensemble moderniste du South Side regroupant des immeubles bon marché. Cette cité, construite dans les années 1950, avait été conçue sous forme de coopérative, en vue de remédier à la pénurie de logements chez les familles noires modestes après la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, la pauvreté et la violence des gangs entraîneraient la dégradation de ces immeubles qui deviendraient un des lieux d’habitation les plus dangereux de la ville. Mais bien avant cela, quand j’étais encore toute petite, mes parents – qui s’étaient rencontrés à l’adolescence et s’étaient mariés vers 25 ans – acceptèrent une offre qui les conduisit à s’installer quelques kilomètres plus au sud, chez Robbie et Terry, dans un quartier plus agréable.
Sur Euclid Avenue, nous vivions à deux ménages sous un seul toit, pas très grand. À en juger par son agencement, le premier étage avait probablement été destiné à loger une ou deux personnes appartenant à la même famille que les occupants du rez-de-chaussée, mais nous nous débrouillions pour y tenir à quatre. Mes parents dormaient dans l’unique chambre à coucher tandis que Craig et moi partagions une pièce plus spacieuse qui aurait dû, je pense, servir de salon.Plus tard, quand nous avons été un peu plus grands, mon grand-père – Purnell Shields, le père de ma mère, un menuisier enthousiaste, à défaut d’être très compétent – a apporté des panneaux de bois bon marché pour fabriquer une cloison de fortune divisant l’espace en deux pièces plus ou moins isolées. Il a ajouté une porte en accordéon dans chaque partie et aménagé sur l’avant un petit espace de jeu commun, où nous pouvions ranger nos jouets et nos livres.
J’adorais ma chambre. Elle était juste assez grande pour contenir un petit lit et un bureau étroit. Je disposais toutes mes peluches sur mon lit, les rassemblant laborieusement chaque soir tout autour de ma tête pour me rassurer. De son côté de la paroi, Craig vivait une sorte d’existence en miroir avec son propre lit poussé contre la cloison, parallèlement au mien. La partition était si mince que nous pouvions bavarder au lit le soir, nous amusant souvent à nous jeter une chaussette roulée en boule de part et d’autre de l’espace de vingt centimètres qui séparait le haut de la cloison du plafond.
Tante Robbie, quant à elle, avait transformé sa partie de la maison en une sorte de mausolée, emmaillotant ses meubles de housses en plastique, froides et collantes sous mes jambes nues quand j’avais l’audace de m’y asseoir. Ses étagères étaient bourrées de figurines de porcelaine auxquelles nous n’avions pas le droit de toucher. Il m’arrivait de laisser planer ma main au-dessus d’une famille de caniches en verre qui avaient l’air gentils – une mère délicate et trois minuscules chiots – avant de la retirer précipitamment, redoutant la colère de Robbie. Quand elle ne donnait pas de leçons, un silence de mort régnait au rez-de-chaussée. La télévision n’était jamais allumée, la radio non plus. Je ne suis même pas sûre qu’ils se soient beaucoup parlé, en bas. Le nom complet du mari de Robbie était William Victor Terry, mais, je ne sais pourquoi, nous ne l’appelions que par son nom de famille. Terry était comme une ombre, un monsieur distingué qui portait des costumes trois pièces tous les jours de la semaine et ne disait pas un mot, ou presque.
J’avais fini par considérer l’étage et le rez-de-chaussée comme deux univers différents, régis par des sensibilités rivales. Au premier, nous étions bruyants, et sans vergogne. Nous jouions à la balle, Craig et moi, et nous nous courions après dans tout l’appartement. Nous aspergions le sol du couloir de cire à plancher pour pouvoir glisser plus vite sur nos chaussettes, nous cognant souvent aux murs. Nous organisions des matchs de boxe frère contre sœur à la cuisine, utilisant les paires de gants que papa nous avait offertes pour Noël, accompagnées d’instructions personnalisées sur la meilleure méthode pour balancer un coup droit. Le soir, nous jouions à des jeux de société en famille, nous racontions des histoires et des blagues, et écoutions des disques des Jackson 5 sur la chaîne stéréo. Quand Robbie n’en pouvait plus, elle actionnait avec insistance l’interrupteur de notre cage d’escalier commune qui commandait aussi l’ampoule du couloir de notre étage, allumant et éteignant, encore et encore – une façon plus ou moins polie de nous prier de bien vouloir baisser d’un ton.
Robbie et Terry étaient plus vieux. Ils avaient grandi à une époque différente et avaient d’autres soucis que nous. Ils avaient vu des choses que nos parents n’avaient pas vues – des choses que Craig et moi, dans notre puérilité tapageuse, n’aurions même pas pu imaginer. C’était ce que ma mère nous disait quand les ronchonnements du rez-de-chaussée nous mettaient à cran. Même si nous ignorions ce passé, on nous demandait de nous rappeler que ce passé existait. Tout le monde sur terre, nous répétaient nos parents, était porteur d’une histoire invisible, et méritait d’être considéré avec un minimum de tolérance. Bien des années plus tard, j’ai appris que Robbie avait engagé des poursuites contre l’université Northwestern pour discrimination, car elle s’y était inscrite en 1943 à un atelier de musique chorale et n’avait pas pu obtenir de chambre dans la résidence universitaire féminine. On lui avait conseillé d’aller s’installer dans un immeuble de la ville où on louait des chambres – un endroit pour les « gens de couleur », lui avait-on précisé. Quant à Terry, il avait été autrefois porteur de la Pullman sur une des lignes de trains de nuit au départ et à l’arrivée de Chicago. C’était un métier respectable mais mal payé, exercé exclusivement par des Noirs qui veillaient à ce que leurs uniformes soient toujours immaculés, alors même qu’ils trimbalaient des bagages, servaient des repas et, plus généralement, satisfaisaient tous les besoins des passagers, allant jusqu’à cirer leurs chaussures.Terry parle, qu’il révèle tous ses secrets. J’imaginais qu’il avait une multitude d’histoires passionnantes à raconter sur les villes qu’il avait traversées, sur ce que faisaient, ou ne faisaient pas, les riches qui prenaient le train. Mais nous ne saurions jamais rien de tout cela. Pour je ne sais quelle raison, il n’en a jamais parlé.
Je devais avoir 4 ans quand j’ai décrété que je voulais faire du piano. Craig, qui était alors au cours préparatoire, effectuait déjà des virées au rez-de-chaussée pour des leçons hebdomadaires sur le piano droit de Robbie et en revenait à peu près indemne. Je pensais être prête. En réalité, j’étais plus ou moins convaincue d’avoir déjà appris à jouer du piano, par un phénomène d’osmose verticale – toutes ces heures passées à écouter d’autres enfants batailler avec leurs morceaux. J’avais déjà la musique en tête. Tout ce que je voulais, c’était descendre chez ma grand-tante pointilleuse et lui montrer quelle petite fille douée j’étais, lui faire comprendre que je n’aurais aucun mal à devenir la plus brillante de ses élèves.
Le piano de Robbie se trouvait dans une petite pièce carrée sur l’arrière de la maison, à côté d’une fenêtre donnant sur le jardin. Il y avait une plante verte dans un coin et, dans un autre, une table pliante où les élèves pouvaient travailler à leurs exercices de solfège. Pendant les cours, elle s’asseyait, droite comme un i, dans un fauteuil rembourré à haut dossier, tapant la mesure d’un doigt, la tête inclinée, à l’affût de la moindre erreur. Avais-je peur de Robbie ? Pas vraiment, mais elle avait indéniablement quelque chose d’effrayant ; elle incarnait une forme d’autorité rigide qui m’était inconnue. Elle exigeait l’excellence de tous les enfants qui posaient leurs fesses sur son tabouret de piano. Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver.Plusieurs années après son départ à la retraite, Terry vivait toujours Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver. dans un état de formalité léthargique – impeccablement habillé, vaguement servile, ne s’affirmant jamais d’aucune manière, à mes yeux en tout cas. C’était comme si, pour s’en sortir, il avait renoncé à une partie de lui-même. Je le voyais tondre notre pelouse dans la chaleur accablante de l’été avec ses belles chaussures bout golf, ses bretelles et son borsalino à bord étroit, les manches de sa chemise élégante soigneusement retroussées. Il se permettait une cigarette par jour, pas davantage, et un cocktail par mois – et, même en cette occasion, il n’était jamais détendu comme pouvaient l’être mon père et ma mère après avoir pris un apéritif ou une bière, ce qui leur arrivait plusieurs fois par mois. Au fond de moi, j’avais envie que Terry parle, qu’il révèle tous ses secrets. J’imaginais qu’il avait une multitude d’histoires passionnantes à raconter sur les villes qu’il avait traversées, sur ce que faisaient, ou ne faisaient pas, les riches qui prenaient le train. Mais nous ne saurions jamais rien de tout cela. Pour je ne sais quelle raison, il n’en a jamais parlé.
Je devais avoir 4 ans quand j’ai décrété que je voulais faire du piano. Craig, qui était alors au cours préparatoire, effectuait déjà des virées au rez-de-chaussée pour des leçons hebdomadaires sur le piano droit de Robbie et en revenait à peu près indemne. Je pensais être prête. En réalité, j’étais plus ou moins convaincue d’avoir déjà appris à jouer du piano, par un phénomène d’osmose verticale – toutes ces heures passées à écouter d’autres enfants batailler avec leurs morceaux. J’avais déjà la musique en tête. Tout ce que je voulais, c’était descendre chez ma grand-tante pointilleuse et lui montrer quelle petite fille douée j’étais, lui faire comprendre que je n’aurais aucun mal à devenir la plus brillante de ses élèves .Le piano de Robbie se trouvait dans une petite pièce carrée sur l’arrière de la maison, à côté d’une fenêtre donnant sur le jardin. Il y avait une plante verte dans un coin et, dans un autre, une table pliante où les élèves pouvaient travailler à leurs exercices de solfège. Pendant les cours, elle s’asseyait, droite comme un i, dans un fauteuil rembourré à haut dossier, tapant la mesure d’un doigt, la tête inclinée, à l’affût de la moindre erreur. Avais-je peur de Robbie ? Pas vraiment, mais elle avait
indéniablement quelque chose d’effrayant ; elle incarnait une forme d’autorité rigide qui m’était inconnue. Elle exigeait l’excellence de tous les enfants qui posaient leurs fesses sur son tabouret de piano. Je voulais la gagner à ma cause, la conquérir peut-être. Avec elle, on avait toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver.
Perchée sur le tabouret pour mon premier cours, j’avais les jambes ballantes, trop courtes pour toucher le sol. Robbie m’a donné mon propre cahier d’exercices pour débutants, ce qui m’a ravie, et m’a montré comment placer correctement mes mains sur le clavier. « Bon, concentre-toi, m’a-t-elle dit, me grondant avant même que nous ayons commencé. Trouve-moi le do du milieu. »
Quand on est petit, on peut avoir l’impression qu’un piano possède mille touches. On a sous les yeux une étendue de noir et de blanc plus longue que deux petits bras écartés. Le do du milieu, n’ai-je pas tardé à apprendre, était le point d’ancrage. C’était la frontière entre le territoire de la main droite et celui de la main gauche, entre les clés de sol et de fa. Il suffisait de poser le pouce sur le do du milieu pour que tout le reste se mette en place automatiquement. Les touches du piano de Robbie présentaient une subtile irrégularité de couleur et de forme ; à certains endroits, des fragments d’ivoire s’étaient détachés avec le temps, donnant au clavier l’aspect d’une rangée de dents gâtées. Par bonheur, il manquait tout un angle au do du milieu, un coin à peu près de la taille d’un de mes ongles, ce qui m’aidait à placer correctement mes mains à tous les coups.
J’ai découvert que j’aimais le piano. Il me paraissait tout naturel d’en jouer, comme si j’y étais destinée. Les musiciens et les mélomanes étaient nombreux dans ma famille, surtout du côté de ma mère. Un de mes oncles jouait dans une fanfare professionnelle. Plusieurs de mes tantes chantaient dans des chorales paroissiales. Robbie, elle, en plus de sa chorale et de ses leçons de piano, avait monté l’Operetta Workshop, un atelier de théâtre musical à tout petit budget pour les enfants, auquel nous assistions, Craig et moi, tous les samedis matin dans le sous-sol de son église. Mais le vrai pilier musical de la famille était mon grand-père Shields, le menuisier, et petit frère de Robbie. C’était un homme insouciant, ventripotent, au rire communicatif, qui portait une barbe poivre et sel en bataille. Quand j’étais plus petite, il habitait l’ouest de la ville, le West Side. Mon frère et moi l’avions donc surnommé Westside. Lorsqu’il est venu s’installer dans notre quartier l’année où j’ai commencé à prendre des cours de piano, nous l’avons dûment rebaptisé Southside.
Southside s’était séparé de ma grand-mère plusieurs dizaines d’années auparavant, quand ma mère était adolescente. Il vivait avec ma tante Carolyn, la sœur aînée de ma mère, et mon oncle Steve, son plus jeune frère, à deux rues de nous seulement, dans une confortable maison de plain-pied qu’il avait équipée pour la musique du sol au plafond, installant des haut-parleurs dans toutes les pièces, jusque dans la salle de bains. Il avait fabriqué dans la salle à manger un système compliqué de placards pour ranger son matériel stéréo, en grande partie récupéré dans des vide-greniers. Il avait deux platines dépareillées auxquelles s’ajoutaient un vieux magnétophone à bandes branlant et des étagères ployant sous les disques qu’il avait accumulés au fil des ans.
Southside se méfiait de beaucoup de choses. C’était une sorte de vieil adepte endurci des théories du complot. Comme il ne faisait pas confiance aux dentistes, il n’avait pour ainsi dire plus de dents. Il ne se fiait pas à la police et pas toujours aux Blancs non plus, car il était le petit-fils d’un esclave géorgien et avait passé sa petite enfance dans l’Alabama du temps de la ségrégation, avant de se rendre dans le nord, à Chicago, dans les années 1920. Quand il avait eu des enfants, Southside n’avait pas ménagé sa peine pour leur éviter tous les ennuis – les terrifiant à grand renfort d’histoires réelles et imaginaires sur ce qui pouvait arriver aux enfants noirs qui avaient le malheur d’aller dans le mauvais quartier, les sermonnant pour qu’ils s’efforcent de ne jamais avoir affaire à la police.
La musique était sans doute un antidote à ses soucis, une manière de les oublier et de se détendre. Quand Southside avait touché sa paie pour une journée de travail de menuisier, il lui arrivait de s’autoriser une folie et de s’acheter un nouveau disque. Il organisait régulièrement des fêtes de famille, obligeant tout le monde à s’égosiller pour couvrir le son qui provenait de la chaîne. Nous célébrions la plupart des grands événements de notre vie chez Southside ; c’est ainsi que, au fil des ans, nous avons déballé nos cadeaux de Noël sur la musique d’Ella Fitzgerald et soufflé nos bougies d’anniversaire sur celle de Coltrane. À en croire ma mère, dans sa jeunesse, Southside s’était fait un devoir d’inoculer le jazz à ses sept enfants, n’hésitant pas à réveiller toute la maisonnée au point du jour en faisant passer un de ses disques à plein volume.
Son amour pour la musique était contagieux. Une fois Southside installé dans notre quartier, j’ai passé des après-midi entiers chez lui, prenant des disques au hasard sur ses étagères et les posant sur la chaîne, chacun me plongeant dans une aventure différente. J’avais beau être petite, j’avais le droit de toucher à tout. C’est Southside qui m’a acheté plus tard mon premier disque, Talking Book de Stevie Wonder, que je gardais chez lui sur une étagère réservée à mes disques préférés. Si j’avais faim, il me préparait un milkshake ou nous faisait frire un poulet entier pendant que nous écoutions Aretha, Miles ou Billie. Je portais Southside aux nues. Et les nues, telles que je les imaginais, ne pouvaient qu’être un endroit plein de jazz.
Chez moi, je continuais à travailler dur pour progresser. Assise devant le piano droit de Robbie, je n’ai pas tardé à connaître parfaitement mes gammes – le phénomène d’osmose était on ne peut plus réel – et je me suis plongée dans les exercices de déchiffrage qu’elle me donnait. Comme nous n’avions pas de piano chez nous, je devais travailler en bas, sur le sien. J’attendais donc le moment où elle n’avait pas d’élève et traînais souvent ma mère avec moi, l’obligeant à s’asseoir dans le fauteuil capitonné pour m’écouter jouer. J’apprenais un morceau du manuel, puis un autre. Je n’étais sans doute pas meilleure que les autres élèves de ma grand-tante ni moins maladroite, mais j’étais motivée. Pour moi, le simple fait d’apprendre était magique. J’en tirais une forme de satisfaction exaltante. D’abord, j’avais saisi la corrélation simple et encourageante entre le temps que je consacrais à travailler et les résultats que j’obtenais. Et j’avais aussi senti en Robbie quelque chose de trop profondément enfoui pour qu’on puisse parler de vrai plaisir, mais tout de même, l’ébauche d’une forme de légèreté inhabituelle, de bonheur presque, qui émanait d’elle quand je parvenais à jouer tout un morceau sans le saboter, quand ma main droite faisait jaillir une mélodie pendant que la gauche frappait un accord. Je le remarquais du coin de l’œil : les lèvres de Robbie se desserraient imperceptiblement ; le doigt qui tapait la mesure effectuait un petit sautillement.
Ce fut pour nous une période d’état de grâce. Peut-être aurions-nous pu poursuivre sur cette lancée, Robbie et moi, si j’avais été moins curieuse et plus respectueuse de ses méthodes d’apprentissage du piano. Mais le manuel était si gros et mes progrès sur les premiers morceaux si lents que je me suis impatientée et que, furtivement, je suis allée voir plus loin – ne sautant pas seulement quelques pages, mais me plongeant au cœur du manuel, consultant les morceaux destinés aux élèves plus avancés et me mettant, pendant mes séances de travail personnel, à bricoler pour parvenir à les jouer. Le jour où, toute fière, j’ai entamé un de ces morceaux devant Robbie, elle a explosé, dénigrant mon exploit d’un fielleux « Bonne nuit ! ». Je venais de me faire houspiller comme je l’avais entendue houspiller je ne sais combien d’élèves avant moi. Je n’avais fait qu’essayer d’apprendre plus, et plus vite, mais Robbie y voyait quasiment un acte de trahison. Elle n’était pas impressionnée, mais alors pas du tout.
Pas plus que je n’étais contrite. J’étais le genre d’enfant qui aime obtenir des réponses concrètes et pousser les raisonnements jusqu’à leur aboutissement logique, si épuisant que cela puisse être. J’étais une ergoteuse tendance dictatoriale, comme pouvait l’attester mon frère, qui se voyait souvent expulsé autoritairement de notre espace de jeu commun. Quand j’estimais avoir une bonne idée, je n’aimais pas qu’on m’interdise d’aller jusqu’au bout. Voilà comment ma grand-tante et moi avons fini par nous heurter de front, aussi remontées l’une que l’autre, et aussi inflexibles.
« Je ne comprends pas que tu sois fâchée contre moi simplement parce que j’ai eu envie d’apprendre un nouveau morceau !
– Tu n’es pas prête. Ce n’est pas comme ça qu’on apprend à jouer du piano.
– Mais je suis prête. Je viens de te le jouer.
– Ce n’est pas comme ça qu’on fait.
– Mais pourquoi ? »
Les cours de piano sont devenus une épreuve épique et épuisante, en grande partie à cause de mon refus de suivre la méthode que Robbie voulait m’imposer et du refus de Robbie d’accorder le moindre crédit à mon approche désinvolte de son manuel. Dans mon souvenir, nous avons passé des semaines à nous disputer. J’étais têtue ; elle aussi. J’avais un point de vue ; elle aussi. Entre nos querelles, je continuais à jouer et elle continuait à m’écouter, me noyant sous un torrent de critiques. Je ne la créditais guère de mes progrès, et de son côté elle ne m’en attribuait guère le mérite. Il n’empêche que les leçons ont continué.
À l’étage, mes parents et Craig trouvaient tout ça très amusant. Ils s’écroulaient de rire à table quand je racontais mes joutes avec Robbie, fulminant encore tout en dévorant mes spaghetti et mes boulettes de viande. Craig, lui, s’entendait très bien avec Robbie : c’était un garçon joyeux et consciencieux, qui ne s’investissait que superficiellement dans l’étude du piano. Mes parents n’exprimaient pas la moindre compassion pour mes tourments, pas plus, au demeurant, que pour ceux de Robbie. En règle générale, ils n’intervenaient pas dans des questions autres que scolaires, nous laissant rapidement, mon frère et moi, régler nos affaires tout seuls. Ils semblaient estimer que leur tâche consistait essentiellement à nous écouter et à nous soutenir, au besoin, entre les quatre murs de notre maison. Je sais que d’autres parents auraient pu reprocher à leur enfant d’être aussi impertinent avec un adulte, mais les miens m’ont laissée faire. Ma mère avait vécu par intermittence avec Robbie depuis ses 16 ans, obéissant à toutes les règles ésotériques que celle-ci lui imposait, et peut-être était-elle secrètement satisfaite de voir quelqu’un défier son autorité. Avec le recul, je crois que mes parents appréciaient ma pugnacité et je leur en sais gré. C’était une flamme qui brûlait en moi et qu’ils s’employaient à entretenir.
Une fois par an, Robbie organisait un récital en bonne et due forme pour donner à ses élèves l’occasion de jouer devant un vrai public. J’ignore encore comment, mais elle avait réussi à obtenir qu’on mette à sa disposition une salle de répétition à l’université Roosevelt, au centre de Chicago, ce qui lui permettait de donner ses petits concerts dans un grandiose bâtiment de pierre de Michigan Avenue, juste à côté de la salle où se produisait le Chicago Symphony Orchestra. La seule idée d’y aller m’angoissait. Notre appartement d’Euclid Avenue se trouvait à une quinzaine de kilomètres au sud du quartier d’affaires du Chicago Loop qui, avec ses gratte-ciel étincelants et ses trottoirs bourrés de monde, m’apparaissait comme un autre univers. Ma famille ne se rendait au cœur de la ville qu’une poignée de fois par an, pour faire un tour à l’Art Institute ou assister à une pièce de théâtre, voyageant tous les quatre comme des astronautes dans la capsule spatiale de la Buick paternelle.
Mon père ne manquait pas une occasion de prendre le volant. Il adorait sa voiture, une Buick Electra 225 couleur bronze, qu’il appelait avec orgueil la « Deux vingt-cinq ». Elle était toujours lustrée et cirée, et il était très à cheval sur le calendrier d’entretien, la menant chez Sears pour faire changer les pneus et l’huile avec autant de régularité que maman nous conduisait chez le pédiatre pour des bilans de santé. Noucher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon s adorions la Deux vingt-cinq, nous aussi. Avec ses lignes douces et ses feux arrière étroits, elle avait une allure cool et futuriste. Elle était tellement spacieuse qu’on avait l’impression d’être dans une maison. Je pouvais presque m’y tenir debout, caressant de mes mains le plafond recouvert de tissu. À l’époque, le port de la ceinture de sécurité n’était pas obligatoire, si bien que, la plupart du temps, Craig et moi chahutions à l’arrière, nous penchant au-dessus du siège avant pour parler à nos parents. Je faisais la moitié des trajets le menton calé sur le siège du conducteur, pour placer mon visage juste à côté de celui de mon père et voir exactement la même chose que lui.
La voiture offrait à la famille une autre forme d’intimité, une occasion de parler tout en nous déplaçant. Le soir après le dîner, Craig et moi demandions parfois à mon père de nous emmener faire un tour, sans but particulier. Certaines soirées d’été, nos parents nous faisaient la surprise de nous conduire dans un cinéma en plein air, au sud-ouest de notre quartier, pour voir La Planète des singes. Nous garions la Buick au crépuscule et nous installions pour la séance. Ma mère nous servait du poulet frit et des chips qu’elle avait apportés et mon frère et moi mangions sur nos genoux, sur la banquette arrière, en faisant attention de bien nous essuyer les mains sur nos serviettes et pas sur les sièges.
Je ne comprendrais que bien des années plus tard ce que cette voiture représentait pour mon père. Enfant, je ne pouvais qu’en avoir l’intuition – la libération qu’il éprouvait au volant, le plaisir que lui procuraient la marche régulière du moteur et le bourdonnement de pneus parfaitement équilibrés sous lui. Il n’avait pas encore 40 ans quand un médecin lui avait annoncé que l’étrange faiblesse qu’il avait commencé à ressentir dans une jambe n’était que le début d’un long et probablement douloureux déclin qui s’achèverait par la pcher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon aralysie ; qu’il y avait de fortes chances pour qu’un jour, à la suite de mystérieuses lésions de la gaine des neurones de son cerveau et de sa moelle épinière, il ne puisse plus marcher du tout. Je n’ai pas retenu les dates précises, mais je crois que la Buick a fait son apparition dans la vie de mon père à peu près au même moment que la sclérose en plaques. Et, bien qu’il ne l’ait jamais dit, la voiture lui apportait certainement une forme indirecte de libération.
Ni lui ni ma mère ne se sont appesantis sur ce diagnostic. Nous étions encore à des décennies du temps où une simple recherche sur Google aurait livré une masse étourdissante de graphiques, de statistiques et d’explications médicales propres à faire naître ou disparaître l’espoir. En tout état de cause, je pense que mon père n’aurait pas voulu les voir. Malgré l’éducation religieuse qu’il avait reçue, il n’aurait certainement pas prié Dieu de lui épargner cette épreuve. Il ne se serait pas mis en quête de thérapies alternatives, ne se serait pas tourné vers un gourou, n’aurait pas blâmé quelque gène défectueux. Dans ma famille, nous avons la solide habitude de refouler les mauvaises nouvelles ou d’essayer de les oublier, presque dès l’instant où elles arrivent. Personne ne savait depuis combien de temps mon père s’était senti mal avant d’aller consulter un médecin pour la première fois ; mais, à mon avis, il a dû attendre des mois, sinon des années. Il n’aimait pas les rendez-vous médicaux. C’était le genre d’homme à accepter ce qui lui arrivait et à continuer à aller de l’avant.
Ce que je sais, c’est que, le jour de mon grand récital de piano, il marchait déjà avec une légère claudication : son pied gauche était incapable de suivre parfaitement le droit. Tous les souvenirs que je garde de mon père comprennent une manifestation quelconque de son infirmité, même si aucun de nous n’était encore tout à fait prêt à employer ce mot. Je savais à l’époque qu’il marchait un peu plus lentement que les autres papas. Je le voyais parfois s’arrêter avant de gravir une volée de marches, comme s’il devait réfléchir à la manœuvre avant de la tenter. Quand nous allions faire des courses au centre commercial, il s’installait à l’écart sur un banc, surveillait les sacs ou faisait une petite sieste pendant que le reste de la famille se baladait tranquillement.
Je me revois le jour où nous nous sommes rendus en ville pour le récital de piano, assise sur la banquette arrière de la Buick dans une jolie robe, chaussée de souliers vernis, mes cheveux tressés. J’étais en proie au trac pour la première fois de ma vie. Jouer m’angoissait, même si en bas, ccher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon hez Robbie, j’avais travaillé mon morceau jusqu’à l’épuisement. Craig était lui aussi sur son trente et un, et s’apprêtait lui aussi à jouer. Une perspective qui ne lui faisait ni chaud ni froid. En fait, il dormait à poings fermés sur la banquette arrière, la bouche ouverte, l’air bienheureux et parfaitement paisible. Du Craig tout craché. Sa sérénité ne cesserait jamais de m’étonner. À l’époque, il jouait dans une équipe junior de basket qui disputait des matchs toutes les semaines et, de toute évidence, il avait déjà appris à maîtriser ses nerfs.
Mon père choisissait généralement un parking aussi proche que possible de notre destination : il préférait payer un peu plus cher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine lcher pour réduire la distance à parcourir sur ses jambes branlantes. Ce jour-là, après avoir trouvé sans difficulté la Roosevelt University, nous nous sommes dirigés vers la salle, sonore et immense à mes yeux, où devait avoir lieu le récital. Je m’y sentais minuscule. D’élégantes fenêtres qui allaient du sol au plafond donnaient sur les vastes pelouses de Grant Park et laissaient apparaître, au loin, les remous écumants du lac Michigan. Des chaises gris acier disposées en rangées impeccables se remplissaient lentement d’enfants inquiets et de parents impatients. Et tout devant, sur une estrade surélevée, trônaient les deux premiers quarts de queue que j’aie vus de ma vie, leurs couvercles de bois écartés telles les ailes d’un grand oiseau noir. Robbie était là, elle aussi, qui s’affairait dans une robe fleurie, comme la reine du bal – une reine légèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien mon égèrement matrone –, vérifiant qu’aucun élève n’avait oublié sa partition. Quand le moment est venu de commencer, elle a fait faire silence à la salle.
Je ne me rappelle pas dans quel ordre ses élèves ont joué ce jour-là. Tout ce que je sais, c’est que, quand mon tour est venu, je me suis levée, et je me suis avancée avec toute la dignité possible jusqu’à l’avant de la salle. J’ai gravi les marches et je me suis assise devant un des pianos étincelants. J’avais beau trouver Robbie cassante et inflexible, je n’en avais pas moins assimilé son goût pour la rigueur. Je connaissais si bien monmorceau que j’avais à peine besoin d’y penser. Il suffisait que mes mains se mettent en mouvement.
Il y avait pourtant un problème que j’ai découvert dans la fraction de seconde qu’il m’a fallu pour poser mes petits doigts sur les touches. J’étais devant un piano irréprochable, aux surfaces soigneusement époussetées, aux cordes accordées avec précision, ses quatre-vingt-huit touches disposées en un ruban blanc et noir sans défaut. L’ennui était que je n’étais pas habituée à une telle perfection. Je n’y avais même jamais été confrontée. Je n’avais jamais joué du piano ailleurs que dans la petite salle de musique exiguë de Robbie, avec sa plante en pot hirsute et sa vue sur notre modeste jardin. Le seul instrument sur lequel j’avais joué était son piano droit approximatif, avec son patchwork boiteux de touches jaunies et son do du milieu commodément ébréché. Pour moi, un piano, c’était ça – comme mon quartier était mon quartier, mon papa mon papa, ma vie ma vie. Je ne connaissais rien d’autre.
Et voilà que, soudain, j’ai eu conscience que des gens me regardaient depuis leurs sièges, alors que j’avais les yeux rivés sur la surface lustrée et parfaitement uniforme des touches du piano. Je ne savais absolument pas où poser les mains. La gorge nouée, le cœur battant, je me suis tournée vers le public, m’efforçant de ne pas laisser voir ma panique, recherchant le havre sûr du visage maternel. Au lieu de quoi, j’ai aperçu une silhouette se lever de la première rangée et l'éviter lentement dans ma direction. C’était Robbie. Nous nous étions déjà beaucoup bagarrées, au point que je la considérais un peu comme une ennemie. Mais au moment précis où je n’allais recevoir, après tout, que ce que je méritais, elle s’est approchée de moi presque comme un ange et s’est arrêtée derrière mon épaule. Peut-être avait-elle compris mon désarroi. Peut-être savait-elle que les inégalités du monde venaient de m’apparaître silencieusement pour la première fois. Ou peut-être n’avait-elle simplement pas de temps à perdre. Quoi qu’il en soit, sans un mot, Robbie a doucement posé un doigt sur le do du milieu pour que je sache où commencer. Puis, se retournant avec un imperceptible sourire d’encouragement, elle m’a laissée jouer mon morceau.FIN
Couverture : Création graphique : Christopher Brand © Librairie Arthème Fayard, 2018, pour la traduction française.
Dépôt légal : novembre 2018
ISBN : 978-2-213-70787-7
Dépôt légal : novembre 2018
Adaptation de la maquette de couverture : Nuit de Chine
Photographie : Miller Mobley
Cet ouvrage est la traduction intégrale,
publiée pour la première fois en France,
du livre de langue anglaise :
Becoming
publié aux États-Unis par Crown,
marque de Crown Publishing Group,
division de Penguin Random House LLC, New York.
© Michelle Obama, 2018 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Harmonie32 le 9 Janvier 2019 à 20:43
Les merveilles de la création la lumière et les couleurs
Quand tu regardes une fleur colorée, un ciel étoilé ou une cascade impressionnante, penses-tu à celui qui les a créés ?
**********************************************************************
L"aile du papillon
LES ailes du papillon sont si délicates que le poids de quelques grains de poussière ou gouttelettes d’eau suffirait à entraver le vol de l’insecte. Mais heureusement, ses ailes restent propres et sèches. Quel est son secret ? Des chercheurs de l’Université de l’Ohio se sont penchés sur l’espèce Morpho didius. Ils ont remarqué que, bien que les ailes de l’insecte aient l’air lisses à l’œil nu, elles sont en fait recouvertes de minuscules écailles qui se chevauchent, comme les tuiles d’un toit. Ces écailles possèdent sur leur surface des rainures parallèles qui permettent d’évacuer facilement les saletés et les gouttes d’eau. Les ingénieurs cherchent à imiter la structure de ces ailes afin de produire des revêtements de haute technologie anti-poussière et anti-humidité. Ces revêtements seraient utilisés dans la fabrication de matériel industriel et médical. L’aile du papillon est une des merveilles du monde vivant que la science essaie d’imiter. Le chercheur Bharat Bhushan observe d’ailleurs : " La nature regorge de chefs-d’œuvre d’ingéniosité, de l’échelle microscopique à l’échelle macroscopique, qui inspirent les humains depuis des siècles. "
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Harmonie32 le 23 Décembre 2018 à 13:47
Son mari a disparu 6 semaines après leur mariage, 68 ans après elle découvre la vérité.
Près de sept décennies après avoir épousé une personne qu’elle considérait comme l’amour de sa vie, Peggy Harris a appris la vérité sur sa disparition soudaine.
Évaporé
Peut-être que l’époque différente, ou le fait que Peggy tenait tant à Billie, mais elle n’a jamais cessé de chercher des informations sur l’endroit où il se trouvait. Ne plus jamais revoir son mari après seulement six semaines de mariage peut sembler comme l’ultime rupture de contrat, mais Peggy savait au fond de son cœur que Billie ne pouvait pas disparaître comme ça. Quelque chose n’allait pas.
Ne pas abandonner
Pour découvrir ce qui est arrivé à son mari, Peggy devait être prête à retrousser ses manches et à creuser profondément. Au fil des années, elle a contacté toutes sortes de gens et a rassemblé le peu d’informations qu’elle avait pu rassembler, essayant de relier les points, mais sans succès. Billie n’était plus là, tout comme toute trace de preuve qui pourrait indiquer où il pourrait être. Pourtant, étant une femme décidée, Peggy n’était pas prête à baisser les bras.
L’inconnu
L’histoire de Billie et Peggy montre qu’en dépit du fait d’être dans l’inconnu, l’amour authentique reste toujours présent. Même si Peggy avait traversé beaucoup de choses au cours de sa longue vie, la seule chose qu’elle n’était pas prête à abandonner était son seul véritable amour. De nombreuses personnes ont été inspirées par l’histoire d’amour de Peggy et Billie, elle, malgré les aléas de la vie, gardait l’espoir que les choses fonctionnent pour le mieux.
Une rencontre peu commune
Née à Vernon, au Texas, dans les années 20, Peggy Seale venait d’avoir 18 ans lorsqu’elle a commencé à travailler comme mécanicienne à la base aérienne d’Altus, dans l’Oklahoma. Peu de temps après, elle a rencontré Billie par l’intermédiaire de son père, qui était superviseur adjoint dans la même base. Le père de Billie était sûr que Peggy et son fils s’entendraient bien, et il avait raison. Peggy était gentille, belle et intelligente, mais elle avait quelque chose de plus que les autres.
Une jeune femme unique
Peggy était si unique qu’elle était la seule femme mécanicienne sur la base aérienne d’Altus, dans l’Oklahoma. À l’époque, il n’était pas courant de voir des femmes s’enrôler dans l’armée, sans parler de travailler dans un domaine dominé par les hommes comme la mécanique. Mais Peggy a toujours été du genre à faire confiance à son instinct et à suivre son cœur, avec ou sans le soutien des autres, peu importe. Elle savait qui elle était et ce qui comptait vraiment, rester fidèle à elle-même.
Le couple parfait
Après avoir rencontré le père de Billie, qui travaillait dans le département des hélices, Peggy a rapidement été présentée à son fils, qui a adoré son excentricité. Tandis que d’autres filles se pomponnaient et faisaient tomber des hommes riches dans leurs crochets, Peggy se préoccupait de problèmes mécaniques complexes et consacrait tout son temps à servir son pays du mieux qu’elle le pouvait. Au moment où ils ont été présentés, Peggy et Billie ont senti un lien qu’ils ne pouvaient pas nier.
La cour à l’ancienne
Leur première rencontre n’a pas tout à fait été « le coup de foudre », car ils ne se sont pas rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont été présentés l’un à l’autre. La première fois que Billie et Peggy ont échangé des mots, c’était par lettres. Ce genre d’interaction n’est pas quelque chose dont on entend souvent parler de nos jours, mais à l’époque, il était courant que les couples apprennent à se connaître en échangeant des lettres s’ils vivaient loin l’un de l’autre.
C’était inapproprié
Peggy le raconte ainsi : « Un poste se libérait au sein du bureau de contrôle de la production et je l’ai accepté. Le père de Billie était le directeur adjoint du service des hélices. Peu de temps après mon arrivée, il voulait que j’écrive à son fils, qui était alors élève-pilote et je lui ai fait savoir que je n’écrivais pas à des hommes que je ne connaissais pas, en particulier des militaires ». En effet, Peggy n’était pas disposée à agir de manière déshonorante.
Prendre le contrôle
Peu après, Billie a entendu parler de Peggy par l’intermédiaire de son père et a décidé de prendre les choses en main : « J’ai commencé à recevoir des lettres de Billie. J’avais un peu peur de cet homme qui ne m’avait pas vu, mais pensait que j’étais bien. Quand il a eu une permission (de l’armée), tout à coup, la porte de l’avion s’est ouverte et Billie Harris a dit “Bonjour Peggy”, et c’était à peu près tout ».
Basé sur l’amitié
Billie vivait à San Antonio, à une certaine distance de la base de Peggy, donc l’envoi de lettres était le moyen le plus simple de faire connaissance. S’étant « rencontré » grâce à la Poste, le couple a commencé à attendre avec impatience d’avoir des nouvelles l’un de l’autre. Leur amitié s’est épanouie et le lien s’est renforcé avec chaque lettre. Après un certain temps, les lettres sont devenues légèrement plus légères. Ils étaient manifestement en train de se « courtiser ». Les lettres demeuraient respectueuses et tendres.
Cloches de mariage
Peggy et Billie ont suivi les règles. Après avoir appris à se connaître par lettres, Bille a senti qu’il était temps de passer àl’étape suivante. Il a fait sa demande à Peggy, qui n’a pas tardé à répondre par « oui ». Après un nombre considérable de courriers, il était évident qu’ils voulaient progresser dans leur cour. Ainsi, le 22 septembre 1943, Peggy et Bille se marièrent dans l’état ensoleillé de Floride. Malheureusement, Peggy et Billie ignoraient ce qui allait se passer.

Complètement brisé
Ils étaient très pauvres. En fait, Billie et Peggy étaient tellement fauchés que Peggy n’avait pas d’autre choix que d’offrir à Billie sa bague de classe de de la Vernon High School en lieu et place de la traditionnelle alliance, car elle n’avait tout simplement pas les moyens d’en acheter une. L’avenir était incertain et les temps étaient durs, mais pour Peggy et Billie, cela n’avait pas d’importance. Tout ce qui les intéressait, c’est qu’après tout ce temps, ils pouvaient finalement être ensemble et mariés.
Un départ difficile dans la vie
En se tournant vers l’avenir, il y avait beaucoup de points d’interrogation sur la tournure que prendrait leur vie commune. Alors que Peggy et Billie souhaitaient tous les deux fonder une famille, ils devaient rester réalistes et comprendre qu’ils n’avaient aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Ils ont évalué toutes leurs options jusqu’à ce qu’ils concluent que Billie devrait être le principal soutien de leur famille. Mais ce n’était que le début de leurs problèmes.
Puis les nouvelles sont arrivées
Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils ont reçu des nouvelles bien plus pénibles. Billie était d’humeur festive pour deux raisons, l’une sur le plan personnel : il a épousé la femme de ses rêves et avait hâte de commencer leur vie ensemble. L’autre était professionnel,
Billie avait terminé avec succès sa formation de pilote de l’U.S. Army Air Corps à Brooks Field à San Antonio. Cette réussite s’est accompagnée d’un tout nouveau grade de sous-lieutenant et d’une lettre déclarant que c’était à son tour de servir son pays pendant la guerre.
Le grand coup
Billie et Peggy ne voyaient aucune solution. Aussi triste que cela puisse paraître, ils avaient fait le serment de protéger leur pays, jusqu’au point de mettre leur vie en jeu, ce qui allait à l’encontre de leur engagement de rester ensemble quoi qu’il arrive, aussi longtemps qu’ils vivront tous les deux. Ils n’ont pas pu passer autant de temps ensemble qu’ils l’espéraient et l’idée d’avoir des enfants n’était plus une option.
Affronter la réalité
Peggy regardait en silence son mari rassembler ses affaires et se diriger vers le quartier général. Cela semblait injuste, passé si peu de temps ensemble et devoir se séparer, mais Billie n’avait pas le choix. C’était son devoir, qu’il prenait au sérieux et dont il s’enorgueillissait. Fonder une famille devrait attendre son retour, bien qu’au fond d’eux ils savaient que cela n’était pas garanti.
Pas d’échappatoire
La Seconde Guerre mondiale battait son plein. Les Américains étaient recrutés sur une base quotidienne, en particulier les hommes qui montraient un fort potentiel et des compétences utiles. Billie savait que son jour arrivait, ce qui explique probablement pourquoi il n’a pas été choqué ou alarmé lorsque la lettre l’appelant à se présenter à Tallahassee et à dire au revoir à ses proches est arrivée. Dans un entretien que Peggy a donné un site internet à la mémoire du 354th Fighter Group, Peggy a expliqué comment elle a géré la situation.
Les femmes étaient démunies
« Son groupe a été emmené à Tallahassee, et les femmes ont été emmenées dans un grand hôtel. » Ensuite, d’autres instructions ont été données aux dames, comme l’a expliqué Peggy : « Quand les hommes ont été appelés, on a dit aux femmes de rentrer chez elles et de ne dire à personne que leurs maris avaient été envoyés à l’étranger jusqu’à ce qu’ils y soient arrivés sains et saufs ». Les temps étaient durs, mais il n’y avait pas grand-chose à faire. Peggy et Billie ont dû composer avec le fait qu’après seulement six semaines de mariage, ils devaient se séparer.
Secrets tenus
En effet, on a demandé aux épouses de ne rien dire au sujet de l’envoi de leurs maris à l’étranger pour prendre part à la guerre, jusqu’à la réception de la confirmation qu’ils étaient arrivés sains et saufs. Mais malheureusement pour Peggy, l’annonce qu’elle a reçue au sujet de l’arrivée de Billie en Europe serait le dernier signe de vie qu’elle recevra de lui. Le manque d’information sur le lieu où se trouvait le lieutenant Billie Harris était dû à une désorganisation menant à un imbroglio bureaucratique au sein de l’armée américaine.
Le chaos
L’armée s’emmêlait tellement les pinceaux qu’elle a donné des informations erronées à Peggy concernant l’endroit où se trouvait son mari. Le quartier général suprême des Alliés en France a indiqué à Peggy que son mari était sain et sauf, qu’il rentrait chez lui, mais rien ne saurait être plus loin de la vérité. Après que les autorités ont commis une série d’erreurs concernant son conjoint, Peggy a compris que si elle voulait revoir son mari, elle n’avait pas d’autre choix que de le trouver par ses propres moyens.
Une totale absence de méthode
Peggy a connu un enfer : « Un télégramme est arrivé, au moment où je l’ai ouvert, il m’est tombé des mains. Après un certain temps, je l’ai regardé à nouveau, puis je me suis rendu au bureau de poste et j’ai apporté avec moi des lettres de Billie écrites après la date du télégramme. Le télégramme disait : “disparu : 7
juillet”, et j’avais des lettres, des lettres écrites à la main après cette date. Plus tard, ils sont arrivés à la conclusion qu’ils manquaient des caractères : “Disparu au combat : 17 juillet”. »

Aucune information
Peggy s’accrochait à toutes les bribes d’informations qui lui était envoyées, essayait de relier les morceaux et appréciait le peu de soutien qu’elle recevait : « On m’a dit de ne pas m’inquiéter, que son cas était sans doute “traité”. Les parents de Billie et moi avons choisi de croire qu’il était de retour aux États-Unis. Nous espérions qu’il était dans un hôpital quelque part et qu’il ne savait peut-être plus qui il était ou qu’il avait perdu la mémoire. Nous avions entendu parler de ce type de cas. »
Faire appel à la Croix-Rouge
Malgré les efforts de Peggy et des parents de Billie pour retrouver ses traces, il avait disparu pour de bon. En mars 1945, Peggy s’était déjà habituée à l’idée qu’elle ne reverrait probablement jamais son mari et qu’il était probablement décédé. Même si la situation était difficile, Peggy se faisait déjà à l’idée et était arrivée à la conclusion qu’aussi horrible soit-elle, elle devait découvrir la vérité et savoir ce qui était arrivé à son mari. Au lieu de fuir la brutale vérité, Peggy a courageusement contacté la Croix-Rouge internationale.
Avancer petit à petit
Avec de nouveaux espoirs à l’horizon, Peggy pensait avoir enfin trouvé une organisation qui l’aiderait à découvrir le sort de Billie. Bien que la Croix-Rouge n’ait pas voulu lancer une recherche officielle pour le retrouver, elle a réussi à dévoiler des bribes d’information et à recueillir des détails qui manquaientauparavant. Soudain, de nouvelles données remontaient à la surface et, pendant un moment, la vérité sur Billie semblait sur le point d’être révélée.
Démunie et sans espoir
Pour la plupart des épouses ou membres de la famille de soldats, des militaires se présentent à leur porte pour annoncer la terrible nouvelle aux proches des soldats morts au combat. Peggy Harris n’a jamais connu cette expérience, elle n’a jamais reçu un télégramme et n’a jamais reçu l’explication qu’elle méritait. Même sept décennies plus tard, Peggy cherche toujours à connaître la vérité et a dit : « Billie a été mariée avec moi toute sa vie, et j’ai choisi de l’épouser pour toute ma vie ».
Suite

 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Harmonie32 le 23 Décembre 2018 à 13:46
La force d’une femme
Tout comme son rôle dans la base aérienne d’Altus, dans l’Oklahoma, Peggy était différente des autres et s’en tenait à ce qu’elle croyait juste. Elle a rejoint l’armée pour devenir mécanicienne et, même si ce n’était pas la norme pour beaucoup de femmes de son âge, elle était engagée et motivée. La même chose s’est produite lorsqu’elle s’est fixé pour tâche de découvrir ce qui est arrivé à son mari, Billie. Sa forte volonté et sa détermination lui ont permis de persévérer, même s’il lui a fallu près de 70 ans pour obtenir une réponse.
Des années de nuits blanches
C’était trop tôt pour fêter ça. Malheureusement, les informations recueillies étaient contradictoires, un rapport prétendait que Billie était sans aucun doute porté disparu et tandis que dans un autre il avait été retrouvé mort. Les recherches ont traîné pendant des années, mais Peggy n’a jamais cessé de chercher la vérité. Les impasses étaient pénibles, tout comme le fait de n’avoir comme seul contact que des personnes apathiques, Peggy n’était pas toutefois prête à s’avouer vaincue. Bientôt, ses recherches s’avéreraient payantes.
Annonce inconsidérée
L’emplacement et le sort de Billie étaient toujours inconnus en 2005, quand le député local de Peggy, le représentant Thornberry, est monté sur scène et a annoncé dans un discours que Billie était disparu au combat. Non seulement Thornberryn’avait absolument aucune idée de ce dont il parlait, mais son équipe n’a pas mené les recherches appropriées, ce qui l’a amené à lancer des affirmations hasardeuses et insensibles. Thornberry a fini par exprimer le regret d’avoir évoqué un sujet dont il ne savait rien.
La mauvaise gestion est un euphémisme
Il s’est excusé d’avoir « mal géré » la situation, mais aucune expression de remords ne pouvait permettre à Peggy de tourner la page. Elle méritait de savoir ce qui était arrivé à son mari. Elle ne savait pas que la vérité était juste sous son nez, attendant d’être découverte par nul autre que la chair et le sang de Billie, son cousin, Alton Harvey. Bien sûr, toute la famille de Billie s’était engagée à découvrir ce qui lui était arrivé, mais après des années passées à fouiller, les recherches étaient terminées.
Réunir tous les morceaux
Alton Harvey était aussi dévoué que Peggy à découvrir ce qui était arrivé à son cousin. Il a expliqué que selon lui « l’histoire ne s’arrête pas à : il est parti à la guerre et n’est jamais revenu, fin de l’histoire ». Il a ajouté « nous devons savoir ce qui lui est arrivé ». Il a donc commencé à demander les dossiers militaires de Billie, ce qui allait être l’étape suivante pour découvrir ce qui était arrivé à Billie Harris.

Je ne l’ai pas vu venir
Harvey a découvert les évènements entourant la disparition de Billie en parcourant les dossiers dispersés et cachés du ministère de l’Armée. Une fois qu’il a eu accès à tout, il était déterminé à découvrir où se trouvait son cousin après toutes ces années. Fait intéressant, tout au long de ses recherches, Harvey a appris qu’il n’était pas le seul à chercher son cousin. En réalité, un autre individu cherchait des informations sur Billie, une Française dont Harvey ne savait rien.
C’était là
Cette femme française avait apparemment demandé les mêmes fichiers parcourus par Harvey, mais avec une différence significative, elle les avait demandés six mois avant lui. Ignorant la raison pour laquelle une étrangère demanderait qu’on lui remette de telles informations concernant son cousin, Harvey était plus curieux que jamais de savoir ce qui était arrivé à Billie. Après des décennies d’incertitude, la vérité était là.
La vérité
Les dossiers ont révélé que le lieutenant Billie Harris était, en fait, affecté au Royaume-Uni. En service, son rôle était de piloter un P-51 Mustang, un bombardier allié, et de traverser la Manche tous les jours. Son éthique de travail exemplaire, ses qualités en matière de travail d’équipe et ses compétences professionnelles ont permis à Billie d’être décoré du Distinguished Flying Across en plus de deux autres médailles composées de 11 grappes de feuilles de chêne. Billie était un soldat rare, prépondérant et patriote, mais ce n’était pas tout.
Sur le chemin du retour à la maison
Ayant accompli près de 100 missions, Billie avait le droit de rentrer chez lui à partir de juillet 1944. Ravi de pouvoir revoir sa tendre Peggy, Billie écrivit à sa fidèle épouse une lettre enthousiaste, indiquant qu’elle lui manquait beaucoup et qu’il allait bientôt rentrer chez lui. Malheureusement, le destin avait d’autres plans concernant l’avenir de Billie, et au lieu de monter à bord du navire qui lui avait été assigné, on lui a dit que son voyage de retour devrait attendre.
Le cœur brisé par la déception
Billie a dû s’asseoir et regarder les autres se frayer un chemin jusqu’au navirequi devait le ramener chez lui parce qu’il y avait trop de blessés à bord. Il n’y avait tout simplement pas assez de place, et pour empirer les choses, le prochain navire en direction des États-Unis partait quelques semaines plus tard. Comme s’ils n’avaient pas assez souffert, la faible capacité du navire empêchait Billie de monter à bord. C’est cet évènement qui a changé leur vie à jamais.
Ce n’était pas son heure
Comme il n’y avait pas grand-chose à faire en attendant le prochain départ, Billie a continué à effectuer des missions pour l’armée. La dernière mission de Billie était aussi ses derniers instants en vie. Son avion a malheureusement été abattu alors qu’il survolait le village des Ventes dans le nord de la France. Alors que son avion chutait en spirale vers le sol, Billie avait une décision cruciale à prendre. N’ayant que quelques minutes devant lui, Billie a fait l’impensable.
La décision qui a changé sa vie
Son avion a été touché. Grâce à ses années d’entraînement, il savait parfaitement ce qui allait se passer. Pesant ses possibilités à la vitesse de la lumière, Billie s’est rendu compte qu’il avait un choix à faire, fuir l’avion en s’éjectant de son siège et sauver sa propre vie, ou rester dans l’avion, le détourner du village français et inévitablement plonger vers sa mort. C’était une décision difficile à prendre, presque impossible pour certains…. Mais pas pour Billie.
L’identité révélée
Bien sûr, Billie a choisi de faire écraser son avion dans une forêt voisine, juste assez éloignée des zones peuplées du village pour ne blesser personne. Comme on l’a appris plus tard, la Française ayant demandé les dossiers de Billie était originaire du village sauvé par le pilote le jour de son décès. Cette femme s’appelait Valerie Quesnal. La raison de sa recherche était que le 60e anniversaire de la libération des Ventes approchait
Ils ignoraient qui il étaitdes Ventes a donc pensé que c’était la moindre des choses d’honorer sa mémoire, ce qu’il fait depuis ce jour-là. Cependant, la commune n’avait pas beaucoup d’information sur son héros, ils ont supposé que le pilote altruiste était un Canadien. Ils l’ont enterré dans le cimetière local et ont parlé de lui à maintes reprises, mais ils ignoraient qui il était.
Des mesures extrêmes
Peu importe qu’il soit d’origine britannique, canadienne ou américaine, ce qu’il a fait était héroïque. Billie a volontairement abandonné sa propre vie et tous les rêves d’avenir qu’il avait, et ce à un très jeune âge, pour le bien des autres, des étrangers, dont il ne connaissait absolument rien. Il a toujours été le premier à faire du bénévolat pendant son service, mettant toujours les besoins et le confort des autres avant les siens, mais cet acte était extrême, même pour lui
Retour à la maison
Lorsque Peggy a entendu parler de l’endroit où se trouvait le corps de son mari, elle a agi rapidement et l’a fait expédier pour qu’il soit près d’elle. Sa dépouille a été transférée dans une tombe du cimetière et mémorial américain de Normandie. Son acte extraordinaire et désintéressé et son courage ont sauvé de nombreuses vies, c’est pourquoi on parle encore aujourd’hui de lui avec admiration dans le village français des Ventes. C’est « la tombe la plus décorée de toute la Normandie » selon CBS News.
Le village qui n’oublie pas
Harvey a découvert que « les citoyens du village se sont faufilés quand les Allemands ne regardaient pas et ont eu célébré ses funérailles et l’ont enterré dans leur cimetière ». Même après toutes ces années, ses actions n’ont pas été oubliées. Selon CBS News, les habitants du village se regroupent sur la place principale, nommée à juste titre Place Billie D. HARRIS, trois fois par an. Bien que Peggy n’ait pas su où il se trouvait depuis des années, le village des Ventes commémorerait le soldat tombé au champ d’honneur.

Toujours un héros
Comme les habitants des Ventes ne savaient pas si Billie Harris avait de la famille qui lui rendrait visite sur sa tombe, ils décoraient sa tombe et rendaient visite au héros de leur village. Même le maire est ému lorsqu’il mentionne le nom de Harris, et on se souviendra toujours de lui comme le soldat qui a sauvé la population de leur village. Depuis que Peggy a appris où il se trouvait, elle aussi envoyait des fleurs dix fois par an à l’endroit où il était enterré.
Hommage payant
Depuis qu’elle a appris la mort de son mari et l’endroit où son avion s’est écrasé ce jour-là, Peggy fait un pèlerinage annuel dans les bois voisins. Elle a fait ces visites avec l’aide de Guy Surleau, le seul témoin encore en vie qui parle en termes élogieux de Billie Harris. Bien que Guy pense qu’il aurait pu faire plus, la réponse de Peggy est : « J’aime à penser qu’il était encore assez conscient pour savoir qu’un ami se tenait à ses côtés », a dit Peggy en sanglotant. « Et que cet homme est cet ami.
Tourner la page
Si Alton Harvey n’avait pas découvert les dossiers militaires de Billie Harris, Peggy n’aurait peut-être jamais eu le fin mot de l’histoire qu’elle attendait tant. Elle a finalement pu découvrir ce qui est arrivé à son mari et les derniers instants avant sa mort, ce qui a fait de lui un héros national. Même s’ils n’ont été mariés que pendant six semaines, cette mission visant à découvrir ce qui est arrivé à son mari pendant près de sept décennies représentait énormément pour Peggy. Elle ne s’est jamais remariée et ne s’est jamais remise de ce qui s’est passé.
Le grand amour vient à bout de tout
Quant à Peggy, elle s’assure de visiter la tombe de son mari tous les jours. « Quand les gens parlent de tourner la page, ce sont des gens qui n’ont jamais vécu quelque chose comme ça », a expliqué Peggy dans l’un des entretiens qu’elle a accordés. Cette histoire de dévotion et d’amour éternel sans frontières est une source d’inspiration pour tous. Peggy n’a cessé d’aimer Billie, pas une seconde. Finalement, c’est sa volonté incessante de découvrir ce qui lui est arrivé qui a finalement permis de découvrir la vérité.
Fin
 7 commentaires
7 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique